|
Etonnements 2002
Que dit-il, le brin d'herbe ? et que répond la
tombe ? Aimez, vous qui vivez ! on a froid sous les ifs…
Ces vers de Victor Hugo Hugo (voir poème intégral en Notes d’écriture) me font à
chaque fois penser à la tombe d’Arthur à Charleville. Une sorte d’if planté
dans une sépulture voisine est devenu envahissant et déborde sur les deux croix blanches
de la famille Rimbaud. Il y a aussi cette impression de froid et de silence et toutes les
questions qui restent au bord des lèvres quand on lit le poète aux semelles de vent.
Cette ambiance détourne le vieil Hugo vers le désormais toujours jeune Arthur. Poètes
figés dans l’éternité, tout aurait pu les séparer et la postérité les a
réunis, étranges destins que celui des poètes où les écrits les pousse vers un éther
de mots volatiles qui bizarrement demeurent tandis que les corps se fossilisent lentement
dans l’ennui : Arthur coincé avec sa mère tout comme Baudelaire, exilé au
Montparnasse et Hugo s’enquiquine dans ses marbres avec d’autres vieilles
barbes. Quand Victor écrivit ce Crépuscule des Contemplations, sans doute le galopin
Rimbaud n’était pas né ou du moins pas en tant que poète. La Meuse coulait
tranquille sous les marronniers vers sa maison natale. Finalement, il se sont toujours
loupé : quand en 1885, VH meurt écrasé sous la gloire générale, AR est déjà
loin, se tait dans son Harar, plante des armes et cultive son cancer, il ne lui reste que
6 ans d’errance à vivre avant de prendre sa part de postérité qui est
" un discours aux asticots " comme disait Céline. Tout cela
n’est pas très gai en ce jour de Noël, non ? Ah oui, j’oubliais de citer
les deux derniers vers de la strophe à Hugo : Lèvre, cherche la bouche ! aimez-vous
! la nuit tombe; Soyez heureux pendant que nous sommes pensifs…
Je pense à la guerre en Irak à la Côte d'Ivoire, je suis heureux de Noël. Aimer,
aimer…
(25/12/2002)
Deux anecdotes cette semaine concernent
l’ANPE. La première est la toute nouvelle agence qui vient d’ouvrir en plein
cœur des rues commerçantes de Châlons (en Champagne qu’on dit maintenant, on a
rajouté des bulles à l’eau glauque de la Marne, ça fait plus gai). Et justement,
en parlant de plus gai, il y a cette ANPE, insolemment ouverte à l’endroit où
fleurissent boutiques de fringues et coiffeurs. D’ailleurs, la décoration luxueuse
rappelle les boutiques des coiffeurs, précisément, parfumeurs et autres soins du corps.
Les premiers jours, les chaises " design " habilement disposées sur
le pourtour demeuraient vides, sans doute question de s’habituer à la nouvelle
implantation (au fait avant, c’était où ?). Et maintenant, quand on passe, on
remarque des gens assis dans le décor impeccable, posés comme des shampoings sur les
étagères du coiffeur. Et c’est une grande honte qu’on ressent devant cette
société qui expose de façon arrogante ce besoin essentiel de l’individu, le
travail, non pas comme une chose naturelle, mais comme un luxe, dont les demandeurs
seraient à la fois, les clients et les produits, tournant dans le cercle infernal du
marketing, parfaitement compris par le premier (non)employeur de France : le besoin
crée le client, le client crée le besoin...
La deuxième anecdote se passe au lycée de ma ville où j’assistais en parent
forcement anxieux à une présentation de la complexe scolarité qui débute en seconde.
Comme intervenant, il y avait une conseillère d’orientation qui après nous avoir
expliqués tous les recours, nœuds administratifs, options et angoisses diverses,
enfonça le clou en signalant que le CIO, Centre d’Information et d’Orientation,
était situé au-dessus des locaux… de l’ANPE ! Raccourci saisissant que
l’ensemble des parents préoccupés par le choix du futur métier de leurs rejetons a
dû apprécier.
Honte à nous qui permettons cela…
(18/12/2002)
Dans le journal de mon département, il ne se
passe pas une journée sans que l’on annonce une publication. Livres de patrimoine,
romans, poèmes : tous les genres sont présents. Articles sur l’auteur du coin,
publicités des maisons d’éditions locales qui présentent un catalogue riche et
renouvelé (l’une d’elles annonce dix titres nouveaux…), la littérature
dite régionale semble bien se porter. Elle est pourtant très différente de cette
littérature plus nationale qui a su s’organiser à travers de circuits de diffusion,
de politique marketing concertée comme la traditionnelle rentrée littéraire de
septembre. Souvent décriée, la littérature régionale est de qualité inégale,
beaucoup d’auteurs publiant en grande majorité à compte d’auteur (mais
beaucoup d’œuvres publiées ainsi sont plus intéressantes que certains produits
commerciaux fabriqués par des auteurs à succès). En dehors des Fnac et autres grands
groupes, reléguées dans quelques rayons cachés de librairie, on cultive vis à vis de
la littérature régionale une méfiance incompréhensible que je perçois à travers un
agaçant élitisme. C’est Pierre Michon qui résume bien le problème en citant dans
une interview récente que, dans sa province, il composait des poèmes de
" sous-Apollinaire, du sous-Baudelaire ". Beaucoup d’auteurs
locaux, gagnés par l’âge, publient leurs poésies rimées, désuètes, issues de
l’époque révolue du Certificat d’études, comme pour laisser une trace à leur
parenté et leurs amis. Peu importe que ce soit pour eux du sous-quelque chose, il
n’empêche que leurs petits enfants, leurs amis ressentent l’émotion de la
lecture. Et ainsi se boucle avec ces lecteurs, le cycle complet de la vie d’un livre
dans une totale littérature régionale complètement ignorée de celle qu’on imagine
plus noble. Et pourtant existante, essentiellement belle.
(11/12/2002)
Qui écrivit le fameux vers : partir,
c’est mourir un peu ? Le surréalisme d’André Breton est-il né à
Saint-Dizier ? Quelles furent les relations entre Diderot et les langrois ? Qui
était Remi Belleau? Pourquoi Alexandre Hatier, Ernest Flammarion et Albin Michel,
éditeurs prestigieux sont-ils originaires d’un département qui a toujours compté
moins d’habitants qu’un seul arrondissement de Paris ?
Questions improbables et réponses hétéroclites dans 52 écrivains haut-marnais : de
Jehan de Joinville à Jean Robinet. Fruit d’un enthousiasme
collectif et d’un travail commun, les Ecrivains de Haute-Marne ont investi dans ce
livre la passion qui les anime depuis 20 ans à faire vivre ce patrimoine à travers leur
association. Tout naturellement, fêter cet anniversaire c’était rendre hommage à
ce patrimoine littéraire extraordinaire.
En effet, cet ouvrage d’art éclaire le paradoxe d’un département à la fois
proche de Paris mais méconnu et qui a pourtant su retenir de tout temps un grand nombre
de femmes et d’hommes de lettres les plus importants de notre histoire. Certains ne
sont pas originaires de Haute Marne et y sont venus par hasard, comme Antoine de Saint
Exupéry, affecté à l’aérodrome d’Orconte ou Voltaire, hôte du Château de
Cirey, mais tous ont trouvé un attrait particulier à cette région de l’Est que
Paul Claudel appelait " Le Grand Magasin du Louvre bondé d’étoffes et de
savons ".
(04/12/2002)
Il y a des jours comme cela, une petite fille et
sa mère dans un train pour Mourmelon (voir en Notes de lecture) et, un peu plus loin, un
retard de deux heures en gare de Chalons. Parfois les voyages ont un goût d’aventure
et d’épopée. On arrive tout de même à Paris, capitale du monde, omni présente et
égocentrique : la première chose qu’on voit en sortant du métro est un
manteau de vison avec une dame dedans, mains dans les poches et qui agite les pans de son
habit pour en éprouver la richesse au côté de son digne mari. On est dans un quartier
chic et en mission ethnologique pour un salon du livre : pendant deux heures, on
pourra observer, bien plus près que les oiseaux migrateurs de mon lac de province, une
faune que l’on croyait naïvement dissoute dans les affres de la révolution. Il
n’en est rien, nom à particules, anecdotes désuètes et dérisoires de familles
guillotinées pour servir de passé commun et voir évoluer ces étranges personnes
parées de rosettes et d’austères costumes, de bijoux et de jupes strictes à
carreaux. La différence entre ce monde et le mien tient en un seul adjectif : aux
mots " vie banale " que j’eus la malchance d’échanger au
cours d’une conversation et pour résumer le propos de mon livre
"Composants ", il me fut adressé un visage interloqué et un rectificatif
cinglant par un de ces autochtones précieux : vie banale, vous voulez dire vie
simple, non ? La différence entre ce monde et le mien est donc un rapport de
domination : on subit une vie banale, on choisit une vie simple. Ce qui montre le
pouvoir encore réel et détenu par cet étrange microcosme, pouvoir qui s’exprima
d’ailleurs par la présence d’un ministre pour cette manifestation réunissant
200 personnes en face de son absence à un évènement de 20000 personnes directement lié
à son ministère quinze jours auparavant... J’en suis ressorti avec l’étrange
idée que la révolution culturelle chinoise n’avait peut-être été pas une
mauvaise idée.
(27/11/2002)
C’est un correspondant de presse d’un
tout petit village qui s’étonne de croiser sur son chemin un agriculteur occupé
tranquillement à charrier une remorque à l’arrière de son tracteur, remorque
constellée d’autocollants Front National. C’est le même qui raconte comment
certains habitants exposent fièrement et sans vergogne des affiches de Le Pen jusque dans
leurs salons. On se dit qu’il exagère, qu’il cherche la plaisanterie par
exemple derrière cette anecdote où le petit Cohen doit défendre avec ses poings dans la
cour de récré les moqueries de ses petits camarades, non pas parce ses parents ne
partagent pas les mêmes idées d’extrême droite que les voisins, mais parce que
c’est peu crédible de les affirmer avec un nom pareil… Et puis on repense aux
dernières élections et à celles d’avant, on se souvient des scores majoritaires du
FN dans ce petit patelin depuis une dizaine d’années. Et ce n’est pas un
phénomène de ras-le-bol, de cités surchargées d’immigrés : la commune
n’a jamais vu s’installer un seul arabe… Mais bon, tout ce qu’on voit
à la télé, mieux vaut prévenir que guérir, et l’insécurité, si j’en chope
un après ma bagnole, je lui colle deux pruneaux, et Maastricht, hein ? avec les
espagnols, portugais, anglais, belges, allemands, italiens, les paysans peuvent plus rien
vendre… Discours rabâchés, entendus, réentendus, répétés jusqu’à plus
soif - et qui donnent soif, paroles en l’air, au bout du compte on se réveille un
jour d’élection, hébétés, les analystes des journaux (installés en ville et bien
loin…) n’y comprennent rien, le correspondant de presse voudrait bien leur dire
que… Mais tiens donne-nous un article sur le départ de la postière, l’accident
au carrefour, l’intervention des employés de l’électricité dans la
commune… Pendant ce temps là, discours rabâchés, sous-entendus et seul Le Pen, lui
qui dit tout haut ce que… Ah, il nous faudrait un homme, un vrai, un dur à la tête
de…
C’est aussi le fait divers de deux habitants d’une semblable commune qui ont
noyé un homme dans le parc d’une ville : " On voulait casser de
l’arabe, on n’en a pas trouvé, on a dû se rabattre sur un
pédé… ", ont-ils expliqué. L’un d’eux a dû se débarrasser de
son blouson aux insignes néo-nazis avant d’entrer dans le bureau du juge, dixit le
journaliste, qui parlait aussi d’individus " acculturels ". On
imagine assez bien les discours rabâchés, entendus, réentendus, répétés
jusqu’à plus soif, télévisuels ou de voisinage, et tenant lieu d’imaginaire
à la place d’une culture. Pourtant, bien des villages tentent de sortir de
l’isolement. C’est le cas de Goncourt qui a donné son nom aux fameux frères et
du coup au prix tant convoité : deux années de suite une foire aux livres a été
organisée avec les habitants, avec les moyens du bord et trop peu de visiteurs. Cette
année, elle a été annulée, les granges des habitants réquisitionnées pour
l’occasion se sont refermées, les discours rabâchés, entendus, réentendus,
répétés jusqu’à plus soif pourront s’y cacher…
(20/11/2002)
Littérature et Peinture, de la méthode : ce
texte de Nicolas Wanlin (consultable sur Fabula)
se rapporte aux travaux de Bernard Vouilloux, notamment La peinture dans le texte,
XVIII°-XX ° siècles. On y trouve ainsi résumé de beaux points de vues, que
l’on pressentait par ailleurs, notamment sur le rapport entre la description et la
peinture. Quelques extraits :
" La théorie moderne de la description insiste sur l’autonomie de
celle-ci. Pour Barthes, la description réaliste n’est pas imitation du réel mais
imitation d’un tableau du réel…/… Ces considérations reposent sur le
double présupposé de l’instantanéité de la perception du tableau et de la
linéarité de la description (simultanéité / successivité). Or il n’y a pas de
perception qui ne soit déjà lecture, il n’y a donc pas de véritable perception
originaire, globale et instantanée du tableau. Une forme de description est déjà
inscrite dans le tableau qui nous le rend visible, c'est-à-dire lisible. Quoi qu’il
en soit, la sémiologie de la peinture, comme la théorie du récit, campent sur la
position d’une linéarité irréductible du langage — donc de la description
— et en font leur problématique centrale. En renvoyant à des textes théoriques de
Claude Simon et Julien Gracq, B. Vouilloux propose que la linéarité du texte est moins
essentielle que la formation de l’image à la lecture par accumulation, persistance,
mémorisation : il faut donc sortir de l’immanence du texte et considérer le
processus de lecture pour comprendre comment fonctionne la description (de
tableau)…/… Quand la description ne se fonde plus, pour délimiter son objet,
sur les figures du tableau, c’est toute la théorie qui est mise en porte-à-faux.
Or, si l’on admet sans mal que la culture sémiotique du XVIIIe siècle soit
impuissante à fournir des descriptions de Kandinsky, c’est un tout autre problème
que de reconnaître que la théorie de la description qui nous permet de rendre compte de
Diderot, voire de Baudelaire, sera impertinente pour des textes de Bonnefoy ou de Proust.
Cela voudrait dire " Deux poids, deux mesures " ! Et pour Vouilloux, " Le
nuage peint représente un nuage — même si, projetant anachroniquement sur lui le
regard que nous portons sur Klee et Pollock, nous nous donnons la licence d’y voir
autre chose ; mais une ligne ne représente pas une ligne, et c’est pourquoi, sans
doute, elle ne réclame pas la description ; celle-ci en est possible, mais elle
n’est pas pertinente. "…/… La description moderne doit rendre compte
de trois aspects de la couleur, " figuratif (ou représentatif), symbolique (ou
sémantique) et digital (ou formel) ". La description métaphorique se substitue à
la description métonymique et échappe ainsi au détour par le discours des figures, le
lexique de la peinture, etc. C’est une rupture par rapport à la description du
tableau classique. La description s’infléchit alors vers la subjectivité et
l’activité métaphorique du descripteur, se détournant en même temps du
référent. On voit ici les facteurs de la réflexivité moderne. Il est alors possible de
caractériser deux tendances, la réaliste et classique qui privilégie la métonymie,
" trope cardinal et tropisme de tous les réalismes, comme le signalait Jakobson
" car elle permet de dire du tableau ce qui peut en être dit comme du réel, et
celle fondée sur la métaphore, plus tournée vers la sensation, son intensité, son
irréductibilité comme autre du langage. Ceci amène donc la question des limites du
langage, de l’"innommable ". "
(13/11/2002)
Les cimetières de campagne, quand est-ce que tu
nous feras un texte dessus ? C’est Albert qui parle quand nous franchissons la
grille. Bruits de nos pas sur le gravier. En guise de réponse : le dernier
cimetière visité c’était celui de Venise (voir dans cette même rubrique le
09/10/2002). Son étonnement. C’est vrai que c’est beau, un cimetière de
village. Pierres moussues, croix de fer, plaques, bouquets renversés par le vent. Il fait
doux. Nous marchons lentement, mains dans les poches. Les autres ont pris de
l’avance, sont déjà réunis un peu plus loin. On, prend un raccourci entre les
tombes. Albert perd l’équilibre, ce n’est pas facile, je le rattrape par le
coude, sa main agrippe une stèle. Nous y voici. Sur la tombe est écrit
" instituteur-écrivain ", je me demande si le mort n’aurait pas
aimé l’inverse. Et cette curieuse manie d’indiquer la profession, le travail
comme le seul don au monde. On est là pour poser une plaque. Il y a cette phrase de Hugo
" la vie est une phrase inachevée " qu’on a complété par
l’accueil que réservait l’ instituteur-écrivain à ceux qu’il
connaissait : " salut vieux soldat ". L'un de nous pose
l'épitaphe et essuie ses larmes en répétant le vieux salut. Puis, on reste sans rien
dire. En se penchant pour saisir la plaque, il a laissé choir sa casquette que je
ramasse : c’est un modèle militaire avec un pin’s du Professeur Tournesol
épinglé dessus. Il a l’habitude de porter aussi un pendentif de Che Guevara, en
guise de provocation. On se disperse. Nous reprenons le chemin à l’envers avec
Albert. Je voudrais lui reparler du Cimetière de Venise, de la petite chouette que mes
enfants avaient trouvée, puis je renonce. Nous arrivons à la voiture. Plus tard, nous
félicitons Albert pour sa verdeur malgré ses quatre vingt-dix ans passés.
(06/11/2002)
Déplacés, détachés, grands, maigres, en un mot
artistes, et vivant de quoi, de rien, subventions, projets, mais intègres, mais fiers,
surtout fiers. Parlant ateliers, choses obscures, obtues. Et Machin ? t’as vu
l’expo de Machin ? Vivant de rien dans un monde ne prévoyant rien, coupant les
fleurs des poètes, obligeant, restreignant. Aumônes, promesses de quelques sous - ce
qu’on appelle projet. Et Truc ? Paraît que Truc cherche à… ? Filant
des coups, des adresses, vivant de quoi, à peine à côté d’autres, semblables,
déplacés, détachés, grands, maigres mais fiers, surtout fiers. De chaque côté
qu’on se tourne les projets, les projets, les sous. Et le monde qui file à côté,
qu’on regarde, qu’on essaie de capturer dedans. Et bidule ? ça se veut une
représentation du monde dans la problématique de l’artiste, qu’il dit Bidule.
Et rencontrés parfois comme déplacés, détachés, grands, maigres, poignée de main
dans l’évitement, en dehors du monde, fiers, surtout fiers, en dehors de tout, de
tous, poignée de main qui reste dans la poche, cœur brisé, on a mal pour le monde.
(30/10/2002)
Il a fallu que l’écrivain Michel Séonnet,
avec sa petite pointe d’accent de Nice, nous lise le dernier chapitre de
" La côte aux Chats " d’Yvon Regin, à l’occasion de Lire
en fête, pour que l’on se rende compte, nous qui l’avons côtoyé sans nous en
apercevoir, du caractère " pagnolesque " de notre conteur local. Dans
ce dernier chapitre, Yvon imaginait un éden truculent pour ses amis de toujours, les
générations d’ouvriers marnavalais, qui ont (mal) vécu la fin de leurs usines
sidérurgiques. Dans ce paradis, Dieu reconstruisait des ateliers et les ouvriers
pouvaient y retourner pour l’éternité. Façon de prolonger une conception
particulière de l’usine, si souvent raillée, honnie, mais lieu malgré tout du
bonheur et de l’amitié, si tant est qu’on puisse donner de l’activité à
tous.
Dernier chapitre donc du dernier livre d’Yvon Regin, déjà bien rattrapé par la
maladie.
Et nous avons vécu sa disparition comme une déchirure. J’attendais son livre lors
d’une de nos réunions d’Ecrivains de Haute-Marne et qu’il puisse me le
dédicacer mais le sort en a décidé autrement. Ma bibliothèque est restée vide de La
côte aux chats. Et puis, il y a eu cette lecture, j’ai retrouvé la superbe gaieté
d’Yvon, j’ai eu l’impression qu’il nous faisait un signe de tout
là-haut, du paradis des marnavalais…
" Et les gerbes d'étincelles qui réjouissaient nos yeux d'enfants sous les
scies, devant les meules et au-dessus des lingotières dans la fosse de coulée se sont à
jamais figées en étoiles brillantes dans la voûte bleue du beau ciel de nos souvenirs,
éclairant des nuits sereines pleines de beaux rêves, où tous les bruits de l'usine,
comme revenus du fond des âges, chantent en une rumeur grandiose, mêlés aux cris joyeux
des enfants dans les cours de l'école Diderot, aux acclamations des supporters de l'Union
Sportive Marnavalaise, à la musique de la fanfare des Forges, à la voix puissante du
curé Blanchot, au chant des cloches de notre église Saint-Charles, à l'appel à peine
assourdi de notre sirène et aux francs rires du monde ouvrier, étrange et rudement belle
symphonie du tout simple bonheur de ce temps là... "
(23/10/2002)
Je voudrais le Monde – avec le supplément
littéraire du jeudi – . Ce devait être au moins le quatrième dépôt de presse,
l’enseigne du petit losange jaune avoisinant souvent avec le cigare rouge du débit
de tabac (et cette manie de faire cohabiter les caractères imprimés – donc
inamovibles, détenteurs de la vérité – avec la fumée et les odeurs de tabac,
univers évanescents, fugaces comme les paroles). Et j’agitais, non pas le globe
terrestre, mais le journal en faisant remarquer l’absence du supplément. Les
buralistes, débitants, libraires me répondaient invariablement " qu’ils
ne l’avaient pas fourni " avec un " ils " désignant,
le livreur, le représentant, la nébuleuse du Monde entier et cette incertitude
devant les mystères du Monde.
Enfin, je finissais par apprendre que le Monde (des livres) ne commençait que
l’après-midi à Paris (moi, qui croyais l’adage, le Monde appartient à celui
qui se lève tôt) et que, si Dieu et les anges (comme dirait Morgiève) étaient bien
lunés (changeons de planète ou d’astre), on tiendrait le Monde dans sa main dés le
lendemain matin en province.
Et le lendemain, j’ai serré le Monde dans ma main. Déçu presque de si peu
d’effort : on se prenait pour Atlas, élevé dans le travail et l’effort,
on aurait voulu porter le Monde sur ses épaules (bien incapable cependant suite à une
chute d’échelle le week-end précédent en allant cueillir des pommes, dureté de la
terre, sa réalité et ses conséquences douloureuses…), et ce petit paquet de
feuilles, on en faisait tout un Monde. Mais l’article était là (voir rubrique
Composants), en quelque sorte tous nos espoirs envers le Monde, sortir dans le grand
Monde, devenir le maître du Monde et avoir réussi le stupide exploit de citer 12 fois le
mot que vous savez dans cette rubrique : 12 fois, soit 2 heures de rotation par mot
du grand Mot, 2000 km sous nos latitudes et ce mélange temps, espace, surréalisme, folie
et petitesse du minuscule bonhomme qui voulait faire partie du … Et si on
l’appelait Raymonde (c’était la muse de Cendrars…) comme le propose Maxime
le Forestier ?
(16/10/2002)
Venise présente deux visages : la caricature
(place Saint Marc, pigeons, touristes (parfois, c’est les mêmes), cohortes
disciplinées de Japonais, grands vikings, gondoliers en costume, bruit, foule, lumière
et précipitation) et l’aquarelle (canal tranquille, silence, ombres, une habitante
passe sur un quai avec un chat dans un panier à roulette...). Le cimetière de Venise qui
occupe entièrement une petite ’île appartient à la deuxième catégorie. Si proche
pourtant de l’agitation, un Vaporetto vous dépose sur ce havre de paix. Peu de
touristes, c’est normal : le repos éternel n’attire pas les vacanciers.
Dés l’entrée, on apprend que Stravinsky et Ezra Pound sont enterrés ici.
Stravinsky, on connaît, envolées d’orchestres. Mais Ezra Pound ?
Vaguement, on se souvient que c’est le nom d’un (d’une ?) poète. On
suit les petites pancartes qui vous guident dans le cimetière. On passe devant le coin
des enfants, puis dans différentes cours ombragées, ici le cimetière grec, là des
tombes catholiques. Ce lieu nous rappelle le point central de Venise aux confins du
christianisme et de ces schismes, de l’orient et de l’occident. Diversité des
monuments donc : élévations cossues de pierre, murs tapissés de caveaux, beaucoup
de photo, des inscriptions en tous caractères, en toutes langues, parfois quelques croix
de bois simples. Grands arbres et feuilles partout. Certains quartiers sont à
l’abandon. On peine à trouver la tombe blanche de Stravinsky. Quelques pièces
russes déposées en hommage. On pénètre dans une petite cour pas très entretenue, un
peu fouillis avec de vieilles tombes moussues : la pancarte indique qu’Ezra
Pound doit être ici. On fait le tour, rien… On s’apprête à quitter
l’endroit quand les enfants s’exclament : ils viennent de trouver une jeune
chouette visiblement perdue, tombée d’un arbre sur la bordure d'un massif
circulaire. Ils restent à la caresser, à la réconforter, voudraient l’adopter et
il faut les en dissuader. Je m’éloigne un peu et, au milieu des tombes éparses,
apparaît une grande pierre avec juste cette inscription Ezra Pound. Plus tard nous
prenons congé de la petite chouette charmante avec son cou mobile, en espérant
qu’un chat ne viendra pas lui faire du mal. Les enfants sont un peu mélancoliques
mais peut-être est-ce la sérénité du lieu.
Plus tard, je me renseigne sur Ezra Pound, tombe en arrêt sur cette phrase des Cantos
et qui me racontera toujours l’escapade au cimetière de Venise " la
beauté par deux fois sous les ormes sauvés par les écureuils et les geais ".
Les poètes ne meurent jamais vraiment.
(09/10/2002)
Le livre de François Bon est un catalyseur :
il suffit de prononcer le mot magique Stones pour que nous levions tous le doigt pour
raconter comment les pierres qui roulent ont marqué, changé, influencé nos vies de 7 à
77 ans, de nos gamins qui nous surprennent devant l’évier à imiter la guitare de
" Satisfaction " jusqu’aux maisons de retraite avec
" Angie " en musique d’ambiance, on ne réalise pas toujours
combien les Stones sont là pour tous.
Donc séquence nostalgie, voici mes Stones à moi.
Tout à commencé par un copain de classe qui m’apprenait la guitare (et le début
d’une vocation pour lui puisqu’il est maintenant directeur d’une école de
musique), accessoirement me filait des disques, c’est comme cela que j’ai
découvert " Aftermath " à 13 ans avec un véritable choc en
écoutant ces rythmes sur le tourne-disque (" La voix de son maître "
et son petit chien sagement assis) muni d’un seul haut-parleur intégré dans le
couvercle, en retournant en tous sens la pochette représentant ces personnages chevelus
censés produire ces sons. Un véritable choc, donc, qui se traduisit par une dévotion
bien caractéristique : être capable de dessiner partout le symbole de la langue
tirée, d’agrémenter la première page du cahier de texte de troisième d’un
portrait de Jagger piqué sur Rock et Folk (qu’on achète maintenant), de tirer sur
les cheveux pourqu’ils descendent plus vite en bas des oreilles…etc. Cette sage
rébellion avait toutefois des effets positifs : je fis de rapide progrès en anglais
grâce aux textes des chansons marmonnés par cœur…
Vive l’anglais, car en France c’était l’époque des mièvreries de nos
Céline Dion et Pascal Obispo de l’époque : " laisse les gondoles à
Venise " de Stone (sic !) et Charden, " J’ai un
problème " par Johnny et Sylvie, " Oui Jérôme c’est
moi " ou " petite fille 73 " par C Jérôme, " Les
filles du mercredi " du groupe Il-était-une-fois (la chanteuse Joëlle est au
cimetière du Montparnasse pas très loin de Baudelaire). Mais ce décalage entre cette
culture anglo-saxonne et celle qui alimentait nos petits bals du samedi soir avec
l’accordéon encore prépondérant, ne tarda pas à se résorber et j’ai cette
fierté d’y avoir modestement contribué en donnant d’abord à dose
homéopathique à mon cousin Philippe, un peu de Beatles, un soupçon de Stones pour
remplacer ses 45 tours de Mike Brant et Frédéric François et en arriver un peu plus
tard à le voir chanter Hon-on-on-on-onky Tonk Women dans les mêmes petits bals sous
chapiteau, agrippé à sa basse (entre temps il avait abandonné la clarinette, l’Air
de Sambre et Meuse et les défilés de l’Harmonie Municipale) entre un
accordéonniste, un guitariste et un batteur (le premier batteur était le fils du
commandant de gendarmerie, les cheveux les plus longs de nous tous). Puis l’époque
s’est dissolue, les vestes en peau de mouton et les charentaises ont investi le folk
français en même temps que notre Bac à passer, nous les avons méprisés comme la
révolte punk qui s’ensuivit, en véritables détenteurs de la vérité Stones que
nous croyions garder.
Aujourd’hui, Philippe ne joue plus qu’à l’ingénieur frenchy vers Chicago,
le guitariste du groupe fait chanter les enfants des écoles, le fils de gendarme a
disparu dans la nature, la légende raconte que l’organiste-accordéoniste, prof de
musique dans un collège et près de la retraite, a toujours à ses pieds les mêmes
sabots en peau de vache qu’il aimait trimballer sur les estrades des bals.
Régulièrement, avec mon autre cousin, on se dit qu’on devrait aller voir les Stones
(la dernière fois, le concert a été annulé). Finalement que reste-il que la vie
n’ait pas mangé ? Simplement de temps en temps, un air à la radio ou sur la
platine cd comme " Sympathy for the devil " la semaine dernière
poussé à fond sur la chaîne et la fille qui rentre du lycée avec une de ses copines,
obligée de lui expliquer que non, ce n’est pas une maisons de fous ici... etc. De
petits riens donc, comme ces quelques heures volées à l’entreprise pour aller
écouter dans la voiture sur le parking l’ami François nous raconter à France
Culture " Les Stones comme votre vie même ". Et fredonner contre ce
maudit temps qui passe " time is on my side ".
(02/10/2002)
Après Tanguy Viel en janvier 2001, c’est Jacques Bon qui arrête son site de
La Petite Fabrique. Et voilà, cela fait un choc et pas seulement virtuel : on
prenait plaisir à lire les rubriques du café de commerce, découvrir les exaspérations,
les bonheurs de Pontivy, une certaine pudeur dont on se sentait proche de quelqu’un
qui n’était plus seulement " le frangin " mais qui vous
ressemblait un peu plus à chaque mise à jour, un qui, comme vous, râle, rigole, un
poète quoi ! Et ça s’arrête…
Les motivations sont à peu près les mêmes que celles de Tanguy Viel et également
écrites dans un petit mot d’adieu : Internet, c’était nouveau, on a
défriché (avez-vous remarqué combien défricher et déchiffrer sont proches ?)
comme les pionniers au Far West et on se trouve maintenant devant la vaste étendue de
désert qui s’organise, la grande rue, le Saloon en face du Croque-mort, la banque,
la prison, on est un peu pris de vertige, quoi faire d’autre ? On est en proie
à des sentiments contradictoires : que va devenir Internet-ville ? Un
paradis ? Une ville fantôme en proie aux vautours ? Et nous dedans ?
Quelle profession ? Shérif ? Pasteur ? Colporteur en élixirs
miraculeux ? Allons, allons, il est temps de partir : on ferme le site.
En proie au doute, je me suis souvent dit que j’allais aussi arrêter ces mises à
jour parfois stupides qui ne font rire que moi et je continue sans savoir trop
pourquoi : peut-être la curiosité de voir ce qui va rester de tout cela dans cinq,
dix, vingt ans, à l’usure extrême de la trame du site. Aujourd’hui, tout se
démode très vite : les petites flammes qui bougent, les petits cœurs pivotants
et autres gifs animés qui nous plaisaient tant il y a seulement deux ans sont maintenant
le comble du ridicule. On ne conçoit plus, un site sans " flash " et
autres logiciels évolués. J’ai un avis contraire, car les graphismes ne sont
qu’illusions, par contre les mots demeurent depuis l’éternité et le moindre de
ceux là, daté, retrouvé dans cinq, dix, vingt ans nous sera précieux, ne serait-ce que
pour savoir qu’il n’apportait rien. Donc, oui, je continue (pour l’instant)
et je revendique un site perso même si cette notion frise la ringardise. Internet a
souvent apporté de vrais échanges tangibles en amitié, en sentiments divers, c’est
devenu une sorte de veillée autour d’un feu de bois virtuel comme au siècle
dernier. Par moment l’un d’entre nous se lève, selle son cheval et part dans la
nuit en chantant : I’m a poor lonesome cowboy… Salut Jacques, à très
bientôt par mail...
(25/09/2002)
Le seul souvenir que j’avais d’India Song tenait en 3 secondes : un
extrait du film lors de la biographie de Marguerite Duras pour l’émission Un
siècle d’écrivains. Et, malgré cette courte durée, c’était un choc
d’exotisme (peut-être dû à l’histoire ? au nom de la chanson et du
film ? – et ce génie qu’avait MD pour trouver de tels titres - ). Sans
doute pas un choc comparable à celui que j’avais reçu en écoutant pour la
première fois Aftermath et Lady Jane (pour rester dans l’actualité
des Rolling Stones, une biographie…), mais quand même…
Puis le hasard a voulu que l’orchestre de l’Ecole de Musique dans lequel joue ma
fille présente ce morceau lors d’un concert dédié aux musiques de film. Et
voilà : j’ai tout retrouvé, le film, la nostalgie, ce gout de pistache de
l’exotisme. La mélodie est très simple, avec un swing assez lent : on revoit
forcément Delphine Seyrig (alias Anne-Marie Stretter) danser dans le salon. Marguerite
Duras raconte qu’elle avait composé cette musique sur le piano de sa maison de
Neauphle-le-Château (voir Notes de lecture de cette semaine). Vrai ? Faux ?
C’est sans importance, cela appartient à sa légende et c’est tout ce mélange
que l’on sait d’elle, ses livres autobiographiques ou ceux de Yann Andréa, ses
entretiens, son goût du théâtre et de la mise en scène jusqu’à sa tombe au
Montparnasse visitée dans des matins et des solitudes semblables à ces livres,
c’est tout cela qu’elle nous laisse, contenu et concentré dans la mélodie
d’India Song : Duras au delà de sa mort continue à faire son cinéma.
(18/09/2002)
" De la connaissance du chien naît la
précision nutritionnelle " : cette phrase qui sonne comme une citation
d’un auteur célèbre (Proust ? Flaubert ? Un philosophe ?
Adorno ?) débute une pub pour Royal Canin, le restant du spot montre un klebs en
train de courir dans un champ sur fond de musique abêtissante issue du film
" Le Professionnel " et qui est devenu le symbole de la marque.
J’ai vu cette pub plusieurs fois au moment des repas quand la télé reste allumée
pour les infos, ce qui fait qu’on subit avant et après ce qui autrefois, au temps
des " réclames ", s’apparentait presque à de la poésie.
Mais là, on en est loin… J’en reste coi à chaque fois : la phrase écrite
apparaît sur l’écran, je tente d’en saisir le sens et aussitôt la musique
planante (enfin si l’on veut…) de Royal Canin vient m’anesthésier
l’esprit, si bien que je n’arrive pas à saisir le sens caché de ce slogan.
J’ai dû la noter pour m’en souvenir. Donc la voilà, et faites comme moi,
répétez là à voix haute pour bien en apprécier le sens philosophique :
" De la connaissance du chien naît la précision nutrionnelle "…
Voilà qui est pensé… Remarquez en passant le (presque) parfait équilibre entre les
deux parties de la phrase séparée par le verbe " naît " dont
l’efficace simplicité apparaît au grand jour... Appréciez le
" de ", qui, associé avec " naît " provoque un
axiome quasi mathématique, (DE la résolution d’une fraction, NAIT un nombre plus ou
moins limité ; DE deux droites parallèles NAIT rien du tout entre les deux…
etc., etc.). – d’ailleurs on pourrait imaginer un concours d’invention de
citations ; je commence le premier : " De la madeleine de Proust NAIT
la tentation nostalgique " - Admirez aussi la locution " connaissance
du chien ", et ce savoir universel ainsi offert. Certains esprits chagrins (mais
ce n’est pas votre cas) pourraient relever l’opposition entre l’optimisme
de la " connaissance " et la quasi injure de
" chien ", bien embarrassante (" quoi faire de son chien
mort " comme dirait l’ami François, ou " Combat de Nègres et de
Chien " de Bernard Marie Koltes …). Et puis à peine avez-vous le
temps de vous appesantir sur cette première partie de la phrase que vous voilà
précipité (j’allais dire comme l’enfant qui vient de naître) dans la
deuxième partie dont la haute technicité vous émerveille : " la
précision nutritionnelle ". Ainsi vous saisissent des images de laborantins en
blouse blanche, aux regards anxieux cerclés de lunettes épaisses, enfilant dans des
paquets Royal Canin des croquettes saisies une à une par des pinces stériles dans un
environnement de pipettes, tubes à essai et vases emplis de liquides fluorescents et
bouillonnants. Le temps de vous remettre, la séance de pub pourtant fort longue est
déjà passée et vous avez loupé votre spot préféré, celui ou Chico dit :
" va chercher bonheur chez ton marchand de journaux, va, va,
va ! ", celui qui vous fait tellement rire avec vos enfants pendant les
heures qui suivent.
(11/09/2002)
L’entre-tenir
! Un machin que l’on percevait bizarre il y a quelques années, un drôle de nom
et le premier thème qui interpellait : pourquoi y-a-t’il quelque chose
plutôt que rien ? Oui, décidément, drôle d’affaire qui s’annonçait
là. Et cette méfiance toute provinciale : ce devait être encore un de ces machins
pour intellos parisiens en mal de création, non ?
Pourtant, L’entre-tenir était
une association crée par François Larcelet et force était de constater qu’il avait
particulièrement réussi une entreprise aussi rare que hasardeuse : doter la ville
d’une véritable librairie où l’on venait depuis plusieurs années fouiller
dans les rayons, où mes enfants avaient découvert la plupart de leurs livres ainsi que
toute la famille par la même occasion. Donc oui, L’entre-tenir
pouvait paraître étrange, mais pas plus que le titre L’attente-l’oubli
de cette librairie qui avait su nous convaincre.
Finalement, la méfiance de ce premier thème sur la cohérence de la ville que l’on
habite depuis vingt ans (et pourquoi remuer ces vieux antagonismes entre vieille ville et
nouveaux quartiers) avait fait son chemin, s’était émoussée au fil de rares
articles dans les journaux et surtout quand le travail de l’association que l’on
percevait obscur jusqu’alors s’était concrétisé par un excellent livre et une
cassette vidéo redonnant cette part d’histoire que l’on considère comme
honteuse que fut la création d’une toute première ville nouvelle à immeubles.
L’année suivante, le deuxième projet s’intitulait Trois fois amen et
devait laisser s’exprimer les habitants de la ville éparpillés en trois religions
mais dont le point commun semblait être l’utilisation du mot Amen. La méfiance
envers L’entre-tenir était
déjà partie et un tel sujet semblait bien courageux en ce qu’il induisait en
lui-même de s’ouvrir aux autres.
La troisième année, c’était l’enthousiasme et l’impatience de savoir ce
qui allait émerger d’une idée comme Lire André Breton à Saint-Dizier sur
la piste des traces qu’avait laissé le créateur du surréalisme dans la ville.
On avait alors fait connaissance avec Michel Séonnet.
La quatrième année, c’était A nos pères, Ah, nos pères et faire parler
les habitants sur leur parenté.
Maintenant c’est la cinquième année d’une aventure qui au départ fut jugée
à tort essentiellement artistique, élitiste… Pourtant, là encore, le thème
choisi, l’ouvrier, concerne la vie essentielle et historique de cette vieille
ville besogneuse. Lire en fête des 18 et 19 octobre en sera le point d’orgue.
Ainsi voici comment en cinq ans L’entre-tenir
a prouvé que l’on pouvait à rendre la ville à ses habitants à travers une
démarche cohérente et courageuse. Et le mot " art ", car il
s’agit bien de cela est revenu en son sens premier : " Sans la
croyance en l’homme, aucun art n’existe ".
Philippe de Jonckheere (auteur de Désordre.free.fr
et lauréat du prix multimédia de la SGDL) à monté le site de L’entre-tenir : passez-y des
heures et mesurez le travail effectué !
(04/09/2002)
Etonnements, oui, on devrait en avoir
des motifs d’étonnements quand on revient de vacances. Venise, le monastère
arménien de San Lazzaro et sa bibliothèque magnifique fréquentée autrefois par
Lord Byron (on a repéré Dante en très vieille édition et la Description de
l’Egypte, suite à la campagne de Bonaparte, trésor inestimable en volumes luxueux
de l’imprimerie impériale). Car bien sûr, comme d’habitude tout ce qui nous
étonne, nous obsède, tourne autour des livres. Lectures de vacances donc aussi comme
autant de plaisir et d’étonnements (voir " Charles Juliet en son
parcours " en Notes de lecture) et réfléchir, faire le point (en Notes
d’écriture), ouvrir ses yeux et s’étonner de tout. On a continué
jusqu’à Naples, paquets d’images aussi … Et les relations familiales si
différentes, plus attentives en ces temps de farniente. Que retenir ? Bizarrement,
trois reproductions inattendues d’Edward Hopper dans le salon d’un gîte rural
vers Evian. C’était sur la route du retour, nous passions voir des amis et ces
tableaux comme une conclusion de ces vacances pour yeux grands ouverts comme l’avait
ce peintre. Et voyager cette année, c’était peut être comme le dit Erri de Luca,
l’écrivain Italien originaire de Naples " suivre le sentiment
"d'inapplicabilité" de soi-même ".
(28/08/2002)
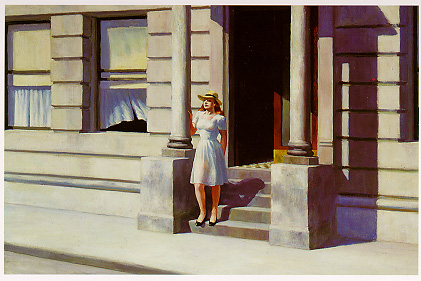
Summer, Edward Hopper
Naples, c’est bien sûr Pompéi, étonnant instantané de la civilisation
romaine antique, figée par l’éruption du volcan ( " Trop beau pour être
vrai " dit Amélie Nothomb dans Péplum) et toute la région entre
Vésuve et Solfatara qui, depuis, en perpétue la fatalité. C’est aussi la
merveilleuse ville et tous nos préjugés franchouillards (la ville peu sûre, la
mafia…) qui volent en éclat tant sont sympathiques et serviables ses habitants,
presque étonnés qu’on s’intéresse à eux. C’est aussi Paestum, ses
temples grecs, ses fouilles immenses à ciel ouvert, visitée au cours d’une journée
torride, à en frôler l’insolation. Et on se réfugie dans le superbe musée du
site. C’est là que se trouve la tombe du plongeur, sarcophage à la mode grecque
orné de peintures intérieures extraordinairement conservées pendant 25 siècles dans
l’obscurité du cercueil de pierre refermé.
Les scènes peintes sont joyeuses : on a effacé la tristesse de la mort qui
n’affecte que les vivants pour en revenir aux désirs du mort, à ce qu’il
aimait. Scènes de repas, d’amitié, d’amour. Mais ces plaisirs bien terrestres
n’ont pas fait oublier la question lancinante du passage, du glissement vers
l’immobilité éternelle. Comment ça se passe et qu’est-ce que l’on
ressent au moment précis ou la dernière impulsion électrique quitte votre
cerveau ? L’artiste a superbement résumé cette interrogation : c’est
un plongeur, peint à l’intérieur du couvercle, le traversant en oblique. Et cette
extraordinaire impression de mouvement destinée à tirer les pensées, un regard
intérieur de celui qui est allongé yeux clos. Il passe, plonge, reste suspendu, retarde
éternellement l’éclat de la dernière étincelle de vie. Bien sûr le tableau est
une épure magnifique : rien n’est en trop, deux arbres implantent la terre,
toute une civilisation de construction s’abrite derrière les traits du fragile
plongeoir, le corps en suspension, détaillé comme la force de l’homme unique,
l’individu qui plonge dans la courbe de l’eau comme dans le dôme du monde. Mais
c’est tout l’ensemble du tableau qui n’est que retenue. Comment ne pas
penser au philosophe Héraclite, l’exact contemporain grec de ce plongeur :
" Cet univers, aucun des dieux ni des hommes ne l'a fait : il fut toujours et il
sera un feu toujours vivant, qui s'allume avec mesure et qui s'éteint avec
mesure. ". (31/07/2002)

C’est le titre d’un fait divers du journal local, horrible comme le sont
souvent les faits divers : un enfant de dix-huit mois se noie dans le bras mort du
canal. Bras mort. Et l’image qui vient, on imagine non pas un bras liquide comme une
vague, un monstre du Loch Ness, qui émerge de l’horizontalité verte et qui cueille
l’enfant, mais une chaleur moite, inquiétante, moussue, qui enserre et qui berce.
Sollicitude mortelle. Le titre qu’on recompose : un enfant dans les bras de la
mort au canal. Et la différence avec ce qu’on avait l’habitude de percevoir
comme un lieu tranquille, oublié, bras mort d’une rivière, refuge de pêcheurs et
de promeneurs, retrait du monde, un bonheur presque, un instant attendu, une pause, une
respiration de la vie, promenade sous un dôme d’arbres, le soleil à clair voies
tachant l’eau comme une fourrure de panthère, ambiance sauvage et chlorophyllienne.
Il y a quelques années j’aimais pêcher dans tous ces bras morts, bout de canaux
coincés entre écluses, voies ferrées, vieux ponts et chemins écartés. Nous partions
avec mon fils pour une à deux heures d’ennui, mais rien n’aurait pu nous y
faire renoncer. La pêche était un prétexte : nous ne ramenions jamais rien et
quand par hasard, une ablette distraite venait se faire prendre, c’était dix minutes
de distraction, le gamin accroupi au bord du seau à regarder le poisson tourner avant de
le relâcher.
Banal canal : c’est le titre aussi d’une chanson composée à dix-huit ou
dix-neuf ans, j’ai encore le refrain dans la tête, une des douze chansons d’un
ensemble intitulé " de l’hiver ", enregistrement maison sur la
chaîne stéréo, un seul interprète pour le chant et la guitare et une cassette produite
à au moins 2 exemplaires (une amie lyonnaise en avait une, l’autre doit être
quelque part dans le vieux stock de cassettes oubliées au fond du garage).
Bras mort aussi et on pense à Blaise Cendrars, sa " main coupée "
à la grande guerre et l’habitude qu’il avait pris de signer ses lettres par
" ma main amie " (et contenu dans l’expression, la seule
l’unique, ouverte et pacifique, en face du fantôme de l’autre perdue au combat,
celle responsable de "j’ai tué "…).
Beauté et laideur, donc, bras mort dans tous les sens, banal canal, fait divers et main
amie n’empêcheront jamais le monde d’être monde : c’est à dire
cruel et heureux à la fois.
(24/07/2002)
Cette semaine, il ne devait pas y avoir de note d’étonnement. Et tout cela
à cause de l’ennui. Il suffit d’un léger relâchement du temps, de l’air,
les enfants en colonie de vacances, par exemple, une pression moindre dans les habitudes,
le travail et très vite l’ennui s’installe, prend la place. Donc rien
n’étonne, ce qui est l’essence même de l’ennui, donc pas de rubrique.
Mais l’ennui justement… Et l’effort qu’il faut pour dépasser cette
exaspérante vacuité, en parler. Car l’ennui draine l’ennui, attire le vide
comme ces trous noirs dans l’espace : on se retrouve en très peu de temps
englué dans une inactivité idiote, un manque de courage. Et bien entendu, cela énerve,
mais le terme est mal choisi, car ce serait déjà avoir une réaction, lutter contre le
vide. Donc, cela déprime au sens atmosphérique, comme une pompe à vélo inversée qui
retirerait l’air des pneus du petit vélo de Perec à guidon chromé au fond de la
cour pour l’empêcher d’avancer. Ainsi, nous voilà bien mal. L'homme est né
pour vivre dans les convulsions de l'inquiétude ou dans la léthargie de l'ennui comme
disait Voltaire, raisonnement très juste mais qui ne résout rien. Alors on sait bien que
seule la poésie peut nous tirer de ce mauvais pas. Pour se secouer faisons nôtre
l’admirable énergie de Rimbaud : Allons ! La marche, le fardeau, le désert,
l'ennui et la colère.
(17/07/2002)
D’abord, il y eut cette réunion de travail prévue à Charleville et
qu’on savait à l’avance difficile. Elle fut rapide, mais dense et on s’est
retrouvé tendu et préoccupé en fin de matinée presque par hasard devant le vieux
moulin qui abrite le musée Rimbaud. On a pris un billet, écouté les explications qui
précisent que le billet est valable aussi pour le musée Arts et traditions populaires
(qu’on préfère nommer ainsi plutôt que musée municipal ou musée d’histoire,
jugés certainement trop rébarbatif ou fonctionnarisé…). On connaît le musée
Rimbaud, c’est au moins la quatrième fois qu’on le visite, mais là –
était-ce cette tension du matin qui empêchait de l’apprécier ? – on
l’a trouvé vieillot - pas suranné, non, ce qui aurait pu avoir du charme-, comment
dire, poussiéreux, pas mis en valeur, sans ordre, décousu, vitrines rectilignes,
moquettes passées, bien en deçà de ce que représente le poète et qu’on pourrait
attendre. Les pièces originales sont rares, à part le sonnet voyelles, quelques étoffes
africaines et la fameuse valise de Rimbaud dont les étiquettes laissent encore lire Aden
avec émotion. On reconnaissait toute cette rudesse bien ardennaise dans l’agencement
de ce musée et on ne pouvait s’empêcher de penser à cette rigueur provinciale, ce
manque d’imagination que Rimbaud a reproché à ces habitants et qui lui ont bien
rendu en l’ignorant la plupart du temps. On est ressorti suffisamment vite
d’ailleurs pour avoir le temps de traverser la place Ducale, dont c’était jour
de marché, et de parcourir au pas de charge avant la fermeture, l’autre musée Arts
et traditions populaires, moderne et spacieux, celui-là. Sans doute est-il plus
facile d’obtenir des subventions pour mettre en valeur les collections
paléontologiques, numismatiques, et autres expositions de vieux pistolets que de
s’échiner à valoriser l’embarrassant garnement qui a bien égratigné ses
compatriotes en son siècle.
Et c’est midi à l’horloge de la place. On redescend lentement vers ce bras de
la Meuse qu’enjambe le musée Rimbaud. On achète un étonnant sandwich à
l’omelette au lard dans une boulangerie. Il fait beau, on regagne la voiture garée
le long de la rivière. Il y a quelques bancs au bord de l’eau. On s’assoit pour
manger. Un vagabond, homme aux semelles de vent, mange une boîte de pâté sur le banc
voisin, il fait signe, aimerait engager la conversation. Derrière soi, on entend le bruit
furieux des voitures qui regagnent les domiciles pour le repas. A droite, le vieux moulin,
tranquille, bel écrin vert de carte postale, enferme dans son silence et sa poussière un
Rimbaud bâillonné. Combien de fois, le jeune Arthur qui vécut sur ce quai presque en
face d’où je suis a-t-il contemplé le lent courant de la rivière ? Deux
cygnes s’approchent, puis une famille de canard, le père la mère, les enfants. Puis
un peu après encore, une mère avec des canetons minuscules, attendrissants. J’ai
mangé tout mon pain, je n’en ai même pas pour eux. Je m’éloigne vers la
voiture. Dans mon dos, je devine le vagabond qui fouille la poubelle dans laquelle
j’ai jeté le papier, la maison d'enfance de Rimbaud nous toise de son regard de
Vitalie.
(10/07/2002)
Boursicotons, boursicotons ! Ce mot
d’ordre à la Zébulon et qui encense l’économie dite " de
marché " n’est pas une idée de droite, contrairement à ce qu’on
pourrait penser. Historiquement, c’est aux environs de 1997 que se répand le
concept de faire participer massivement les salariés à la marche des entreprises
qui les emploient. Le gouvernement de l’époque (Jospin et Strauss-Kahn à
l’économie) ne ménage pas ses efforts pour faire passer cette idée à grand
renfort d’une éthique qui se veut égalitaire : la bourse, c’est pour
tous, les " pauvres " aussi y ont droit (dans le domaine boursier, le
pauvre, c’est la classe moyenne…).
Comble de satisfaction, la bourse de Paris, que l’on croit faussement dopée par
cette soudaine générosité, progresse constamment, laissant croire que les valeurs
informatiques, technologiques représentent un nouvel Eden et, de plus, accessible à
tous. Optimisme partout donc, prompt à faire oublier les avatars d’Eurotunnel, coup
d’essai des petits porteurs, quelques années auparavant.
Ainsi, de nombreuses entreprises ouvrent ou étendent leur capital à leurs employés. On
prend des actions et on regarde mûrir le pactole, imaginant la voiture rutilante, la
maison magnifique que l’on pourra s’offrir quand les délais légaux des
" plans d’épargne d’entreprise " à 5 ans pourront être
soldés. Aveuglés par la brillance de l’or, rendus sourd comme Harpagon par le
tintement de cette monnaie virtuelle, bien peu écoutent les mises en garde des syndicats
les plus à gauche qui répètent que boursiers et ouvriers ne font pas bon ménage.
Allons, allons, ce sont de vieux discours militants, dignes du front populaire, propres à
effrayer le pèlerin. A bas la lutte des classes, soyons pacifiques : tendons nos
poignes rudes aux mains délicates et blanches des habitués de la Corbeille.
Moi aussi, j’y ai cru pour ces deux principes : égalité et pacifisme de
classe.
Cinq ans après, la réalité pécuniaire nous rappelle que la place de Paris que
l’on croyait majeure, reste sous la tutelle d’une économie américaine qui
tousse. Envolés les rêves : la voiture rutilante est une vieille occase et la
maison magnifique se résume à un deux pièces au sixième sans ascenseur.
L’œil morne, tous des pourris, on s’imagine qu’il faut renouer avec la
lutte des classes. Mais quelle lutte ? L’ouvrier contre son cadre, son
directeur ? Le boucher contre le médecin ? Et si c’était l’argent
facile qu’il faille combattre tout simplement, cette utopie qui laisse entendre à
chaque coin de rue : j’ai une combine pour ceci, un plan pour cela, qui rive les
gens à leur écran pour ne pas perdre une miette de lofteurs, de " c’est
mon choix ", de jeux paradisiaques, bref, tout un marketing ambiant et
soporifique.
Et si c’était aussi tout cela qui avait fait perdre la gauche ?
(03/07/2002)
C’est un soir à Paris. On erre un peu avant d’entrer rue de Verneuil
(la maison " Ginzburg " et ses tags, les antiquaires du
quartier…). Tous sont déjà là : trente, quarante… On fait un signe à la
cantonade puis on choisit de serrer la main à tout le monde en signe d’amitié.
C’est un monde virtuel qui se réunit en vrai pour la première fois. Que dire,
comment parler quand on échange seulement dans le silence de courriers électroniques en
temps ordinaires. En plus, il y a du bruit dans la cour, il faut forcer l’attention
pour saisir les phrases échangées (on plaisante : il nous faudrait chacun un micro
portable et discuter sur le net pour se comprendre !). On est content, cependant.
Sourires partout.
Un peu plus tard, il faut bien expliquer, mettre les formes qu’il convient à une
assemblée générale. Le débat, les sollicitations suscitent peu de réactions :
a-t-on du mal à se sortir du silence de nos habituels échanges virtuels ? Mais il y
a ceux qui n’ont pas hésité à faire 800 bornes pour cette soirée, tous ceux qui
sont là, attentifs : le moment est important, on oserait dire historique, du moins
on le perçoit comme tel.
Plus tard, on ne parlera guère plus. C’est comme cela, on préfère écouter,
retenir cette ambiance du premier soir d’été, le bruit d’un repas, la
rectitude habituelle d’une table, des plaisanteries. Le temps passe vite, on se
quitte déjà et c’est à regret. On arpente encore un peu les rues ensemble.
C’est la fête de la musique, il y a des orchestres aux coins des places. Puis on se
sépare encore, pour de bon cette fois. Il fait doux, on flâne un peu tout seul.
Rires : on retrouve un des participants devant une librairie de nuit qui
s’apprête à fermer. Décidément, on ne peut se passer des livres et ceux-çi
finissent toujours par nous réunir !
Enfin, on décide de rentrer à pied. Encore des orchestres un peu partout. Sur un banc,
trois djembés à l’unisson des rythmes. Plus loin, sur un trottoir des danseurs
esquissent une ronde celtique. On arrive à l’hôtel dans cette rue tranquille à
l’écart des bruits. Dans la chambre, on ouvre la fenêtre, on s’attable, on
écrit ceci. Il est une heure du matin, on n’a pas sommeil. On commence à lire Ecrire
de Marguerite Duras. On détache l’étiquette code-barre du livre de poche et on la
colle sous la table de chevet comme on si on voulait garder quelque part et pour des
années le souvenir de cette soirée, de cette rencontre importante.
(26/06/2002)
" Quand Gaudi mourut en 1926, il était une relique embarrassante,
quoique sainte, qui errait dans les rues de Barcelone, ses vêtements usés pendant le
long de son corps affaibli, demandant l'aumône afin de pouvoir achever sa Sagrada
Familia. Le catholicisme en tant que base de la renaissance du régionalisme perdait de
son influence au fur et à mesure que le catalanisme était de plus en plus repris par la
gauche; les courbes organiques du modernisme furent remplacées par les lignes droites du
style international. " (La république des Lettres)
La semaine dernière, en faisant une allusion à la Sagrada Familia (voir en note
d’écriture), je me suis naturellement intéressé à la biographie d’Antonio
Gaudi et cette fin de vie minuscule au sens de Michon m’a rappelé cet
épisode de la biographie de Bernard Moitessier qui, pareil à Gaudi, errait sur les quais
de Papeete à la recherche d’un bout de cordage, d’une récupération pour
permettre à son voilier de rester à flots et pourquoi pas espérer une nouvelle Longue
route. Gaudi, Moitessier : on imagine aussi les dégaines d’un Céline
retranché à Meudon. Je ne sais pas pourquoi je ne retiens que les épisodes
d’ermites de ces deux héros. Peut-être par romantisme. Peut-être pour le partage
de cet ascétisme, qu’il soit religieux ou maritime, vivre de l’air du temps. Et
l’austérité qui m’obsède souvent est dictée par la recherche d’une
écriture épurée, en quelque sorte ce qui resterait après évaporation du sel sur un
quai brûlant de Tahiti, ce qui demeurerait tout en haut des tours effilées de la Sagrada
et ne pas voir en dessous les lignes droites du style international.
(19/06/2002)
En compagnie de mes morts bien-aimés, nous nous promenons depuis près de vingt ans dans
un petit cimetière de Haute-Marne. C’est un endroit villageois à souhait, avec des
chats furtifs, de l’herbe ensauvagée. Au fil des ans s’y sont rajoutés
quelques proches passés de l’autre côté, autant de prétextes à venir. Et mes
enfants, qui connaissaient à peine ces parents, m’accompagnent car, comme tous les
enfants, ils aiment les cimetières.
Nous nous arrêtons auprès de Marcelle Bazar, 1903 - . Voilà.
Et comme à chaque fois, nous nous demandons quand Marcelle Bazar va se décider à
mourir, elle qui a déjà fait graver le principal de sa vie sur sa pierre tombale. Bien
sûr, les années passant, on se demande si Marcelle, au seuil des centenaires, n’est
pas déjà morte et que ses proches ont tout simplement oublié la date. Ou peut-être
l’a t’on retrouvée il y a bien des années, réduite à l’état d’un
parchemin, oubliée de tous au fond d’un jardin… Ou peut-être était-ce un
bébé à peine né ? Marcelle Bazar déclenche notre imagination.
Et finalement, la tentation est grande de résumer sa vie à un nom, une date de naissance
et un tiret. Car la date de mort n’intéresse jamais le principal concerné, le seul
intérêt réside dans le tiret, petit résumé de vie et qui est tout. Et ce qui est en
dehors de ce millimètre d’encre plat, tout ce grand vide nous semble une biographie
étonnamment superflue et nous fait profondément réfléchir : c’est notre
complexe de Marcelle Bazar et que nous aimons retrouver régulièrement…
(12/05/2002)
" Au bout de la ligne F,
Fasthôtel et, un peu plus loin, l’hôtel Quick. Vocabulaire de vies pressées, de
VRP, comme si prendre une chambre au prix modeste dans une de ces chaînes économiques
devait empêcher de se relaxer. Allez ! On dort vite, un peu de sommeil, le repos est
un luxe pas compris dans le prix, on repart... Lequel, donc, on hésite, on opte pour
Fasthôtel, vingt francs moins cher. (…/…) On monte prendre possession de la
chambre sans savoir pourquoi, pas d’affaires à poser, tout tenant dans le sac en
skaï laissé dans le hangar. Chambre 306, code, déclic de la gâche électrique.
L’impression de déjà vu. Le lit à gauche, un autre en travers, bizarrement sans
matelas, juste le cadre métallique suspendu en hauteur et l’échelle pour y monter.
Une porte ouverte, on aperçoit la cuvette des WC, une tablette en laminé blanc coincée
dans le renfoncement de la fenêtre, huisserie en PVC, au-dessus, une télé. Une chaise
en pin, assise en tissu, motifs en zigzags, alternance de bleu, de beige, de gris et de
jaune. On remarque le dessus du lit assorti et, au mur, la reproduction d’un tableau
représentant un voilier quittant un port, une signature illisible. Le revêtement des
murs imite un crépi intérieur, d’une couleur presque indéfinissable, vaguement
bleu pâle, la bordure de la tablette est jaune poussin, de même que l’échelle et
le treillis métallique du lit. Moquette brune, sale, tachée. Odeur de poussière, de
tabac et de pieds. "
C’est un extrait de Composants, prévu pour septembre chez Fayard. Et mercredi
dernier, il y a eu cet imprévu de boulot qui m’a obligé à réserver une chambre en
catastrophe. Sur l’annuaire, j’ai vu Fasthôtel, alors forcement, c’était
comme entrer dans mon livre, aller vérifier ce que j’y écrivais. Par chance, il y
avait encore des chambres disponibles : j’ai eu la 103. 103, 306 : on voit
déjà la proximité des chiffres. Dans la réalité, la chambre était spacieuse et
propre, le dessus de lit avait un tissu quasi-similaire à la description, par contre, les
murs étaient nus (avec l’inimitable crépi intérieur de ce genre
d’endroit) sans aucun tableau avec juste deux appliques. Il y avait bien une tablette
en laminé blanc et au-dessus une télé. Finalement, hormis le tableau qui manquait, mon
imagination ne m’avait pas beaucoup trompé mais il faut dire qu’en matière
d’imagination, les hôtels économiques de ce style en manque sérieusement. Ce que
j’ai retenu ? Couché à 1h du mat, lever à 7h15 : Fasthôtel, comme dans
mon livre porte bien son nom…
(05/06/2002)
J’ai une vieille passion pour les orchidées. D’abord, les orchidées exotiques
m’ont attiré et j’ai quelques vieux pieds de Cattleyas, Phalaenopsis et
Cymbidiums dont certains ne cessent de me surprendre par leur vigueur après quinze ans de
floraisons étonnantes et opiniâtres et la quasi-absence de soins à leur donner en
échange. Et puis j’ai découvert les orchidées de nos régions, terrestres plutôt
qu’épiphytes comme leurs consœurs exotiques, là encore, elles étonnent par
leur rusticité. Au printemps, c’est toujours émouvant de voir la diversité des
orchis et ophrys qui rivalisent de beauté et qui, pour attirer les insectes
pollinisateurs, n’hésitent pas à imiter parfaitement mouches et abeilles dans leurs
floraisons (on en profite pour remercier Albert Kritter, écrivain haut-marnais, auteur de
merveilleux livres sur la flore et les cours d’eau, d’avoir obtenu que l’on
retarde le fauchage des bas-côtés des routes pour permettre à ces plantes d’avoir
le temps de fleurir et ainsi de se perpétuer).
Tout cela pour dire que j’ai dans ma pelouse bien tondue (voir cette même rubrique
la semaine dernière), quelques pieds d’orchis bouc depuis deux ans. Par quel
mystère cette plante habituée des coteaux calcaires éloignés est-elle venue atterrir
en plein centre ville ?
Et quel est le rapport de ce charmant tableau bucolique avec la littérature ?
Peut-être l’aspect étonnant, beau et tourmenté de cette fleur et sa forte odeur
qui s’exhale le soir venu et qui lui donne son nom, tout comme apparaît Baudelaire,
citadin ensauvagé au caractère fiévreux et ses fleurs du mal aux parfums de
souffre.
(29/05/2002)
Printemps = herbe qui pousse = tondre la pelouse. Chaque année, c’est le même
cinéma : il faut tondre la pelouse. La première tonte, on aime cela :
c’est un peu comme remettre le jardin en ordre, les feuilles mortes de l’hiver
disparaissent dans le bac de ramassage, on tourne autour des pâquerettes ou on tond bien
ras selon les années, mais c’est le printemps et l’espoir des beaux jours qui
pointe ! Et puis, une semaine ou dix jours après tout est à recommencer :
l’herbe animée d’une vigueur nouvelle pousse très vite. La deuxième tonte est
déjà moins marrante et souvent il faut viser entre les jours de pluie. Enfin, c’est
nécessaire, on ne peut pas s’abstenir sinon le jardin va devenir une friche. A la
troisième tonte, on est déjà moins vigilant, on préfère écouter les merles siffler.
Maintenant remplaçons le texte précédent sur le thème des élections.
Tous les sept ou cinq ans, c’est le
même cinéma : il faut aller voter. Au premier tour, on aime cela : c’est
un peu comme remettre nos politiciens en ordre, les vieux ténors de l’hiver, on
aimerait les voir disparaître, on tourne autour des nouveaux prétendants (parfois tondus
bien ras selon les années), mais tous les sept ou cinq ans, c’est l’espoir
d’une vie meilleure qui pointe ! Et puis, une semaine ou dix jours après tout
est à recommencer. Le deuxième tour est déjà moins marrant. Enfin, c’est
nécessaire, on ne peut pas s’abstenir sinon la démocratie va devenir une friche. Au
troisième tour, appelé " les législatives, " on est déjà moins
vigilant, on préfère écouter les merles siffler.
PS : J’ai une passion pour les tondeuses (je crois me souvenir que Philippe
Djian aussi : il parle de sa tondeuse SABO - même marque que la mienne – dans
le recueil de nouvelles Crocoliles) : la dernière acquisition en copropriété
familiale est une tondeuse-débrousailleuse ECO, trois roues, tractée, moteur Brig et
Stratton 5,5CV, largeur de coupe 53 cm, réglage de la hauteur de coupe au guidon.
Utilisable en terrain gras et lourd de type lepennien, hautes herbes chiraquiennes ou
graminées jospiniennes.
(22/05/2002)
Marcher le long des plages, voilà une idée romantique à souhait. Nos clichés :
chaussures à la main, pieds dans l’eau, calquer sa respiration sur le mouvement des
vagues. Nos vieux poncifs : mer éternelle, berceau de la vie, bout du monde, mer et
ciel, cercles de vie, se ressourcer. Oui, c’est tout cela. Ramasser un coquillage, un
galet, sentir le vent, le soleil, cette sensation d’être toujours entre deux
moments, une petite parenthèse tranquille le temps de la marche. Il y avait autrefois une
publicité qui illustrait ces sensations : on voyait un type seul au bord d’une
plage, on entendait le bruit de la mer, c’était pour une radio avec un
slogan du genre écoutez France Inter, ou France Culture, je ne sais plus. Donc, on a
tous quelques souvenirs comme cela..
Pour moi, c’était au début des années 90, en stage pour le travail en Bretagne,
petite respiration solitaire d’une semaine au début d’une vie de famille bien
prenante avec deux petits enfants. J’avais une Audi défraîchie, je découvrais les
Suites pour violoncelle de Bach en rejoignant chaque soir une plage déserte en
décembre : de quoi construire un beau et vrai souvenir, à la Duras ! (il me
semble me souvenir aussi que je pensais à reprendre sérieusement l’écriture après
avoir terminé un premier récit en pointillé depuis…78).
Bien sûr, il y a eu depuis d’autres instants identiques dans des lieux
tellements diversifiés : Méditerranée, Adriatique, Atlantique, Manche, mer des
Caraïbes.
La dernière plage en date c’était la semaine dernière, on retrouvait Quend,
oublié depuis cinq ans, vent permanent, balades en vélo, à pied, vers Fort Mahon, vers
les dunes, on a marché aussi dans le délice d'une accalmie de vent et de deux heures de
soleil : pieds dans l’eau froide, enjambant les coquillages, crabes, couteaux,
os de seiche, les enfants déjà grands à côté. Et plus tard que restera-t-il de
ces sensations ?
(15/05/2002)
Mais les mais ? Cette tradition des
" mais " existe-t-elle chez vous ? Dans les villages de mon
département, il est d’usage de couper quelques jeunes arbres et de déposer chacun
d’eux contre les maisons dans lesquelles il y a des jeunes filles " à
marier ", la nuit du premier mai. Tradition qui, si elle est bien respectée, se
termine par une soirée organisée par les filles pour la jeunesse du village. Je me
souviens avoir été invité dans une de ces fêtes et j’en garde un agréable
souvenir. Par hasard, j’y ai repensé en traversant un de ces bourgs : baliveaux
appuyés contre des façades, poubelles du village regroupées devant l’arrêt de
bus… Bien entendu, cette fameuse nuit, tout est un peu plus permis et mieux vaut ne
pas laisser traîner son salon de jardin si on ne veut pas être obligé d’aller le
récupérer sur la place de la mairie, devant l’église, etc… Mon cousin a dû
ainsi aller chercher du renfort pour descendre d’un toit une maison en plastique qui
sert habituellement de jeu à la plus jeune de mes charmantes nièces. Certains esprits
chagrins s’offusquent de tels débordements. Certains maires vont même jusqu’à
interdire ce genre de manifestation. Mieux vaut d’ailleurs ne pas s’en plaindre
de façon trop exagérée, car tout se sait très vite dans les villages et les habituels
grincheux trinquent souvent plus que les autres (on m’a raconté qu’un irascible
avait eu ses clenches de portes, de volets et ses balustrades de fer forgé enduits
d’une graisse noire et tenace…). Mais pour ceux chez qui la tradition reste
tenace, on en rit, cela fait des souvenirs pour le village et les générations. Et puis,
courir les rues pour aller à la recherche de ses outils de jardins, tuyaux
d’arrosage, jardinières et autres ornements qu’on a l’habitude de laisser
devant chez soi est finalement plutôt bénéfique, c’est une occasion pour
rencontrer vos voisins, de discuter un peu en ce jour de fête du travail. Tout cela à
condition de se laisser un peu aller, de laisser filer le temps, de s’ouvrir
l’esprit, et finalement de réfléchir à deux fois avant de glisser un bulletin dans
l’urne lors d’une élection présidentielle par exemple… La tradition des
mais a été instaurée en 1790 pour fêter dans la joie la Révolution.
(08/05/2002)
Bien sûr, on est obsédé par les présidentielles, on cherche, on cause, on discute dans mon département très rural où Le Pen à fait un carton… Voici deux tentatives d’explications ou réflexions ou anecdotes diverses au sujet du premier tour.
1°) Un flic :
Je connais un flic. La première fois que je l’ai vu, il m’avait aidé à
déménager un piano au premier étage. Et puis d’autres circonstances m’ont
fait le rencontrer : activités associatives communes, humanitaires. Toujours prêt
à rendre service, c’est un type calme, d’une grande patience, avec un air de
sage, aux idées ouvertes. Aimant le dialogue, il préfère rester simple flic et arpenter
la ville en voiture ou sur une mobylette. Il raconte aussi qu’on l’appelle
" poulet, poulet… " sur son passage. Il ne dit rien, ne répond
pas : c’est la consigne. Ne rien faire qui puisse être interprété comme de la
provocation, sa présence en uniforme dans les quartiers d’immeubles est déjà
perçue comme telle. Il dit aussi que son boulot est difficile à cause des trafics
illégaux qui augmentent (avec parfois la bénédiction cynique d’élus : je me
souviens avoir été directement témoin des paroles d’un maire, fier de déclarer
que la ville avait de l’argent, peu lui importait sa provenance du moment qu’il
soit dépensé dans les supermarchés et commerces de la ville…). En effet, de
l’argent circule : il y a eu une hausse de 59 % de saisies de drogue en 2001
dans mon département d’après un article du journal local.
Mais revenons au flic en question, plutôt modéré, mais qui a voté Le Pen au premier
tour. Surprise ! Moi, qui cherchait autour de moi qui avait voté Le Pen, arrivé en
tête dans ma ville, moi qui imaginait des caricatures d’électeurs - anciens
d’Algérie en " marcel " troués promenant leurs bergers
allemands, bedaine en avant -, me voici en face d’un type que je connais, que
j’estime et qui lui-même est tellement éloigné de la caricature du flic de base.
On a su qu’il a voté FN car il s’est engueulé avec sa fille (à laquelle il a
appris la tolérance et le dialogue…). On dit aussi qu’au cours d’une
manifestation anti-Le Pen organisée par les lycéens suite au premier tour, des
manifestants ont jeté des œufs sur les quelques flics réquisitionnés comme lui
pour faire la circulation. Ne devant ni répondre, ni faire un geste : c’était
la consigne. On croit savoir qu’il votera néanmoins Chirac au deuxième tour.
Je connais un flic, donc. Que j'estime. Il faudra que je pense à l’inviter un soir.
Lui, le flic. Qui a voté Le Pen.
2°) Education Nationale :
La gauche, la gauche : on cherche des explications à l’échec de la gauche dans
notre élection présidentielle. Parfois, on tient des raisonnements, des logiques, des
constats qui nous conduisent à dire que ce n’est pas étonnant (d’où la place
de cet article dans cette rubrique ?). Et puis le problème est multiple : on a
voté massivement Le Pen aussi faute de crédibilité de la gauche dans les départements
ruraux. Dans le mien, certaines explications tiennent peut-être dans d’évidentes
maladresses autour de l’Education Nationale. Il ne s’est pas passé une semaine
depuis la rentrée de septembre sans que le journal relate des manifestations de parents
d’élèves parfois même rejoints par des élus contre la fermeture de classes qui
furent particulièrement nombreuses cette année. L’Inspecteur d’Académie
affiche une logique comptable, (la même logique comptable qui poussa la Sécurité
Sociale à envoyer à ma belle-mère en phase terminale une lettre pour lui reprocher le
coût de ses soins…), logique dont on peut se prévaloir dans un département en
perte de vitesse certes, mais qu’il appartient au gouvernement d’expliquer, de
modérer et non d’enfoncer. Ce discours de réduction a d’autant plus de mal à
passer puisqu’on insiste beaucoup sur l’augmentation des crédits budgétaires
dans ce poste… L’Education Nationale est assimilée à ce gouvernement en tant
qu’administration et, de plus, on imagine souvent des tendances politiques de gauche
à ses fonctionnaires, donc toute maladresse de sa part est rapidement imputée à la
gauche. J’ai entendu à la radio que l’on déplorait l’analphabétisme, le
manque de culture générale qui ont conduit des électeurs à voter Le Pen. Il se dit
aussi qu’on a demandé aux chefs d’établissements de notre département de
faire passer dans chaque classe de troisième un élève de plus en seconde et tant pis
s’il n’a pas le niveau nécessaire. On dit aussi qu’un élève de
troisième a été tabassé hier en dehors d’un établissement pour avoir traité un
autre élève de " bronzé ". On dit aussi que l’élève (que je
connais, franchement du genre timide) dément l’insulte et la provocation, tandis que
ses agresseurs, virés auparavant d’un collège voisin pour agressivités diverses,
ont été versés en cours d’année dans cette classe.
Bien sûr, il y a beaucoup de " on dit " qui se mêlent aux anecdotes,
aux articles des journaux locaux, à l’actualité, à ce dont on est témoin et qui
déforment certainement la vérité. Cependant, l’incohérence apparente de
décisions, de réflexions, l’absence de communication a accentué la déformation
dans la perception de la réalité, d’où malaise, d’où " on nous
cache tout… ", d’où, de fil en aiguille et en passant par
l’Education Nationale, échec de la gauche.
(01/05/2002)
La photo qui fait mal est en page d’accueil. Ce qui fait mal ? Le gamin mort de
trouille entouré par 6 soldats harnachés et armés. Donc le fameux rapport de force avec
la raison du plus fort qui est toujours la meilleure bien entendu.
Dés que c’est disproportionné, cela fait peur : une poignée de nazis pour le
million de civils du ghetto de Varsovie ou 2500 morts à Pearl Harbour et 340 000 en
réponse à Hiroshima-Nagasaki, par exemple.
Mais oublions les chiffres et concentrons nous sur ce gamin terrorisé et peu importe qui
il est. On trouve de ces photos semblables partout : en 40 le gamin était juif et
les soldats allemands, en 45, pas de militaires, les aviateurs américains s’étant
débarrassé de leur fardeau de mort haut dans le ciel, il y avait juste des gamins
brûlés partout en-dessous.
Mais oublions les camps, les partisans, ceux qui croient avoir la bonne raison, le bon
dieu, leur bon droit avec eux, et concentrons nous sur ce gamin terrorisé. Je croyais
naïvement qu’il appartenait aux démocraties de protéger les faibles, de les
rassurer. Je sais, je sais, c’est pas si simple, la situation est difficile,
inextricable, on peut aussi opposer d’autres photos de massacres terroristes...etc.
N’empêche… J’ai juste envie de dire : je ne prends pas parti,
simplement, il est difficile d’admettre que des scènes comme celles-là et
d’autres plus violentes se passent chaque jour.
Et puis non, ce n’est pas vrai, je n’ai pas envie de le dire calmement, de
raisonner, de moutonner dans un grand consensus pacifiste. J’ai envie de le hurler,
de pleurer, d’implorer qu’on arrête tout cela en voyant ce gamin terrorisé.
Cette photo est dans le site d’Olivier Six, www.amnesix.net.
(24/04/2002)
Il y a des jours ! En l’occurrence, c’était plutôt un soir. J’étais
en retard parce qu’il avait fallu passer voir ce qu’il y avait comme tableaux et
cadres pour décorer le local professionnel refait à neuf de mon épouse et qui devait
rouvrir lundi, nous ne trouvions rien dans notre ville, c’était vendredi, et
l’agglomération voisine où je travaille étant distante tout de même de
soixante-dix kilomètres, je ne pouvais remettre cette course. Donc je commençais la
recherche en perdant du temps, d’autant plus qu’attiré par la devanture, fort
sale au demeurant (et non pas " for sale ") d’un encadreur qui
discutait sur le pas de la porte avec une dame enfournant un gros paquet (portrait
d’un docte aïeul ? photo du dernier petits-fils ? ) dans sa voiture qui
bouchait la rue étroite, - et qui plus est, je me souviens qu’une mobylette (pardon,
qu’un booster) ne parvenait pas à passer- , je maudissais déjà cette initiative
tardive (la recherche des tableaux) ainsi que le bruit de la mobylette (pardon, du
booster), d’autant plus que je m’apercevais alors que la boutique en question
n’encadrait que des gravures, posters, peintures et aquarelles que l’on apporte
soi-même, alors qu’il me fallait du tout prêt à pendre pour les murs neufs et
c’est ainsi que je rejoignis ma voiture et démarrai rapidement sinon ce genre
d’histoire risquerait de nous emmener loin.
Au premier feu rouge, il y avait une camionnette antique, modèle Estafette, blanche,
raccommodée, piquée de rouille.
Et déjà, ma mauvaise humeur trouvait une justification supplémentaire pour continuer
mes râleries : je vais encore être plus en retard avec ce tas de ferraille devant
moi alors que j’aimerais tant revenir vers notre bonne ville distante de soixante-dix
kilomètres avant que les magasins ne fermassent pour pouvoir acheter un pot de peinture
bleue et peindre les barres en bois que j’ai fabriquées avec mes petites mains
habiles et imaginées avec pragmatisme afin de bloquer les pieds des chaises pour éviter
que les dossiers ne puissent abîmer le revêtement mural neuf de la salle d’attente.
Il me faudrait la peinture dés ce soir afin de donner une première couche, le séchage
pendant la nuit me permettant d’en donner une deuxième dés le lendemain, vous voyez
bien que ce genre d’histoire risque de nous emmener loin, ce n’est pas comme ce
tas de ferraille bloqué au feu, je veux bien qu’il soit encore rouge, étonnamment
lent ce soir et c’est bien ma veine, mais même au vert, je parierais que le moteur
n’arrivera pas à entraîner ce tas de rouille aux portières arrières ouvertes
laissant voir, en parlant de rouille, une vieille grille de cimetière, en fer forgé,
certainement l’entourage d’une tombe ; l’ensemble encombrant glissé
dans l’Estafette dont les portières arrières, ne pouvant se refermer, sont réunies
d’un bout de ficelle curieusement rouge avec un aspect de ruban satiné et c’est
tout ce qu’ils ont trouvé pour empêcher le chargement de glisser jusqu’à
terre bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’espace entre le bas de la grille et
le sol à voir l’état des suspensions de la vieille camionnette qui semble raboter
le goudron.
Voilà le feu vert !
L’engin se met en branle, avance centimètre par centimètre, on distingue le
conducteur et le passager, deux employés d’une marbrerie funéraires ? Les
parents d’une vieille grand-tante décédée depuis cent ans et à qui appartient la
grille ? Et que vont-il en faire ? La recycler en portes de clôture ? Mais
vous l’avez deviné, toutes ces questions risquent de nous emmener très loin alors
que je guette le feu qui demeure obstinément au vert et que je vais peut-être réussir
à passer en même temps que la vieille camionnette, ce serait un miracle et…
Oui ! J’y arrive ! Je contourne le carrefour, l’Estafette à du passer
la seconde, les silhouettes du conducteur et du passager ne laissent entrevoir aucun signe
d’énervement qui pourraient laisser croire que l’engin va s’arrêter là,
définitivement mort au milieu de la chaussée (ha, ha ! mort comme la vieille grand
tante dont la grille de la tombe est dans la camionnette), quand soudain m’échappe
cette réflexion idiote prononcée à voix haute dans la voiture : avec un tel engin,
on ne risque pas de rouler à tombeau ouvert… Elle est bien bonne : on ne risque
pas de rouler à tombeau ouvert! Je m’esclaffe tandis que devant moi, les deux
portières arrières reliées par la curieuse ficelle rouge tressautent au rythme de mon
rire et que, dans l’autre sens, les conducteurs dévisagent ma face cramoisie et
hilare comme si j’écoutais une bonne blague des grosses têtes sur RTL bien que de
toute façon l’émission soit terminée, vu l’heure tardive, et que tout cela
risquerait de nous emmener trop loin.
(17/04/2002)
Cette semaine, c’est presque rien et
pas de quoi s’étonner en Etonnements. Une anecdote qu’on peut oublier et qui
fond comme neige au soleil ou chocolat de Pâques à la chaleur.
Donc, Pâques !
Cette année, c’était chez mes parents, ce coin de campagne, et magnifiquement tout
était réuni pour disposer les traditionnels œufs de Pâques, ce vieux jeu ! Et
tant pis, si les enfants, les neveux sont aussi grands que vous : j’ai semé les
œufs dans la pelouse, ils ont joué les étonnés. Tout était ainsi réuni : la
pelouse d’herbes neuves, tendre et verte, le prunus en fleurs magnifiques, le papier
doré des œufs dans le soleil, l’ouate du ciel, les chants d’oiseaux…
J’étais content : c’est comme cela qu’on imagine ce genre de
rendez-vous, comme on espère un Noël avec de gros flocons de neige, un quatorze juillet
que les pétards n’ont pas besoin de chauffer, une Toussaint froide et mélancolique
à souhait dans les cimetières.
Mais Pâques ? Depuis combien de temps n’était-il pas arrivé de telles
Pâques ? L’année passée, on ne se souvient de rien. L’année
d’avant, il faisait froid et gris, j’avais mes petits neveux venus de
Guadeloupe, en bottes et qui grelottaient en ramassant les friandises dans la pelouse. On
se souvient aussi d’avoir été les voir là-bas à la même époque et c’était
la traditionnelle fête populaire sur la plage avec le matété de crabes.
Et d’autres souvenirs encore comme ces cartes postales un peu surannées, des cloches
ailées décorées de paillettes collées et qu’on recevait d’amis d’Europe
de l’Est, comme ces œufs peints achetés en Pologne et que l’on conserve
dans des boîtes garnies de coton, comme les pâques étalées dans la cour de la maison
louée à Vivier-sur-Mer, comme les œufs disposés sur le balcon d’un chalet en
Alsace avec la neige inattendue.
Pâques est peut-être la seule fête où tout semble arriver pour bousculer la
tradition…
(10/04/2002)
Il y a cette histoire qui horrifie tout le monde : un type a tué froidement 8
personnes et blessé 19 autres lors d’un conseil municipal à Nanterre. Tué
froidement : ce qui nous glace les os. Froideur, peur bleue, acte prémédité alors
que ce devrait être coup de sang, rouge de colère, folie furieuse.
Non, le type était normal. Une passion pour les armes mais dans son club de tir, on
louait son sérieux, sa discrétion. Un homme discret, un anonyme, votre voisin
peut-être. Vous ou moi (qui n’a pas rêvé un jour de crucifier son percepteur, de
trucider son prof de sport, d’écarteler le conducteur qui vient de vous faire une
queue de poisson…). On ne peut pas y penser sans chercher une explication, une
raison. C’est trop inconfortable, cela voudrait dire que la folie nous guette,
qu’elle attend un moment propice, SON moment, pour taper au hasard sur l’un
d’entre nous. Insupportable expression " passage à
l’acte ". Il faut chercher : voyons, c’était un type qui
s’intéressait à pas mal de choses, pas un introverti… mais justement cela ne
cachait-il pas…? C’est un peu comme mon coiffeur qui n’arrête pas de me
poser des questions, si ça se trouve, un jour quand il aura le rasoir…Brrr !
(Je vais me laisser pousser les cheveux, dorénavant…). Non, on a beau retourner le
drame dans tous les sens, le type, l’assassin, vous le sentez dans votre peau. On
repense à ce vieux refrain de Trust " Antisocial, tu perds ton sang
froid… ". On reste avec notre malaise, rouge sang, peur bleue.
Le lendemain, on apprend que le type s’est suicidé. On souffle… Peut-être que
c’est mieux comme cela… ça met un terme… (à quoi ?). Et puis on
parle tellement d’insécurité en ce moment, cette histoire mettait mal à
l’aise nos candidats aux élections présidentielles, tenanciers d’un discours
forcément ferme (pour avoir des voix) mais pas trop agressif (pour en avoir
d’autres). Ce type et les explications que l’on commençait à chercher, les
dérives médiatiques, le monstre social qu'il allait devenir, quel candidat allait
pouvoir en bénéficier ? Déjà que le silence sur les tensions à
l’international et les morts au Proche Orient deviennent chaque jour plus difficile
à tenir…
(03/04/2002)
Salon du livre spécial Italie à la Porte
de Versailles. Invité pour l’inauguration, on se retrouve bousculé dans un monde
hétéroclite. Presse, métiers du livre, de l’édition, exposants, tous sont réunis
pour l’évènement annuel. Naïvement, en provincial, on s’imaginait arpentant
des allées quasi désertes avec une coupe à la main dans un brouhaha discret, chacun
restant à proximité de son éditeur préféré. Clameurs, tracts, foule compacte, très
vite les stands sont submergés, les verres vides, les petits fours raflés. On échange
quelques mots avec ceux que l’on connaît et que l’on retrouve avec plaisir.
Puis on se sépare pour arpenter ce fameux salon. Clameurs, tracts, oui, car l’Italie
de Berlusconi et sa quasi-absence de politique culturelle a provoqué des manifestations.
Clameurs et tracts encore pour les employés des Fnac parisiennes en grève depuis 15
jours et on sourit devant ces deux symboles du pouvoir économique qui trinquent ce soir,
la culture réduite du PDG Berlusconi et les rayons normalisés des étouffantes Fnac. Il
y a du bruit, du monde, des cigarettes : on sort (on est en ce moment dans une
cyclique période austère : pas d’excès, forme et sommeil, vie de moine) et on
espère que le lendemain sera plus sage. Plus tard, à l’hôtel, on regarde la fin de
l’excellent film " le cercle des poètes disparus " (encore un
succès commercial...) et on termine par un retour au salon du livre en direct avec
Guillaume Durand et Campus. Clameurs, bruits, il s’excuse devant les
téléspectateurs plusieurs fois. Les draps sont frais comme les pages d’un livre, on
s’endort.
(27/O3/2002)
Evidemment qu’on est effrayé devant la violence au Proche Orient (on se souvient
d’avoir cité Ariel Charon, comme " responsable de l’histoire mondiale
en marche " dans cette même rubrique le 12/12/2002). Guerre, donc, et
c’est facile de se souvenir de nos formules " quelle connerie, la
guerre " ou encore " le propre de la guerre c’est d’être
sale " mais les formules, c’est la limite du pouvoir des mots, du même
acabit que la limite du pouvoir des statistiques : que vous ayez 0,0000001 % de
malchance de mourir à l’avenir dans un attentat terroriste ou que votre grand-père
ait pu bénéficier d’être dans les 50 % de rescapés de 14-18 (sans quoi vous ne
seriez pas là), pour celui qui meurt ou qui en réchappe c’est toujours à 100%.
Et tandis que je divague, le journal de ma ville raconte un navrant conflit de voisinage
qui dure depuis des mois, il paraît même que la télévision va s’en mêler.
Conflit d’ennui : la vie est vide, on se recrée un petit Proche-orient en bas
de chez soi pour passer son mal-être.
Et tiens, pêle-mêle, dans ce même journal, on apprend qu’un Ministre est venu
visiter un quartier HLM. Il était, paraît-il, consterné devant la laideur de certains
bâtiments construit dans les années 70 (à l’époque c’était pourtant le top)
mais a ajouté que de toute façon, il n’y avait pas d’argent pour réhabiliter
tout cela. Retour à la case départ. Habitants de ce quartier, lamentez-vous, c’est
moche et on ne fera rien. Faites un conflit de voisinage pour vous changer les
ideés…
Et par une absurde association d’idées, je pense à Magellan qui découvrit en 1520
une mer si grande et si calme qu’il la baptisa Océan Pacifique. Non, finalement, le
pouvoir des mots est immense…
(20/03/2002)
Il y a une expo sur le surréalisme à Beaubourg, on le lit dans des journaux, on
l’entend à la radio, avec cette phrase qui énerve et qui dit à peu près ceci
" L’héritage du surréalisme ? Les auteurs interrogés
(lesquels ? ) pensent qu’il faut moins de querelles de chapelles et peut-être
donner plus de rêve, moins de quotidien ".
Le hasard a voulu que j’aille la veille au Centre Hospitalier Spécialisé de ma
ville, baptisé André Breton parce que celui qui est considéré comme le fondateur du
fameux mouvement y a travaillé.
J’y allais pour rencontrer deux aides soignantes qui montent une bibliothèque pour
un service de convalescence et qui ont pensé à l’association des écrivains de
Haute Marne dont je suis le secrétaire pour venir animer une ou deux après midis.
Cartons dans un bureau minuscule, livres défraîchis : ce sont des dons, la
bibliothèque est montée sans moyen, ce sera une gestion manuelle, le minimum quoi.
Et parallèlement, je pensais à l’association locale l’Entre-Tenir qui s’est établie au sein de ce
CHS avec l’excellent travail réalisé depuis quatre ans avec tous les habitants de
la ville par l’équipe Michel Séonnet, Stéphane Gatti, Benoit Artaud, Katy Kouprie
et François Larcelet.
André Breton a constitué un temps fort de cette animation il y a deux ans.
Le surréalisme, c’est peut-être tout cela, cette suite de hasards, l’idée, la
pensée qui en entraîne une autre, ce sont les images que je garde, décousues : les
cartons et les livres, les sacs en plastique transparent laissant voir des livres de la
collection Arlequin. La pièce minuscule, l’aide soignante qui se demande comment
tout cela prendra forme, le retour vers ma voiture, l’étrange impression de
contentement en passant la lourde grille, la place immense, la sensation du ciel gris en
remontant dans ma voiture.
Le surréalisme, ce ne peut-être plus de…ou moins de… comme plus de rêves ou
moins de quotidien. Le surréalisme, c’est…
" La beauté sera convulsive ou ne sera pas " André Breton (Nadja)
(13/03/2002)
Le hasard d’une formation secourisme
m’a fait retourner au Central de ma ville (l’impression étrange de
" rentrer " à nouveau dans mon premier roman du même titre…).
J’y ai retrouvé avec grand plaisir mes collègues et de ces conversations autour
d’un café me reste l’inévitable mot de " résister " car
tout dans les attitudes, dans les regards, dans les réponses aux questions se résume
dans ce mot.
Oui, travailler dans une petite ville n’est pas facile et vouloir garder son travail
" au pays " est un combat de tous les instants. La reprise économique
tant vantée par les optimistes de tous poils n’est pas perceptible ou du moins se
traduit, comment dire, par une compression globale du travail, dans le temps, et les
technologies, les échanges informatiques et internautiques que j’utilise en ce
moment même abolissent ou automatisent certaines tâches : la somme totale du
travail diminue et les grosses entreprises ont tendance à centraliser ce qui reste.
Donc, dans les petits lieux de production, petites unités, ceux qui restent ont
l’inévitable mot de " résister " éternellement aux lèvres car
on n’a pas tous les moyens de déménager, de trouver ailleurs l’équilibre
qu’on a mis une vie à bâtir entre une famille présente dans la région, une
épouse qui travaille sur place, la maison rêvée qu’on a construite…etc.
" Résister ", c’est insister en permanence pour garder du
travail, éviter qu’il ne parte dans une ville plus grande, c’est
" résister " aux sollicitations pour aller travailler ailleurs,
C’est se faire mal voir, ne pas répondre aux menaces de mutation, aux dénigrements
permanents, c’est accepter de renoncer à toute promotion aussi car dans ces lieux
désertés, les meilleures places partent en premier.
Il faut donc " résister " et ceux dont la retraite est proche, ont ce
sourire d’avoir réussi à maintenir jusqu’au bout une qualité de vie pas si
facile que cela à garder. Cela paraît dérisoire, mais c’est ce qu’on nomme
" bonheur préservé ", un langage que toutes les entreprises du monde
ne peuvent pas comprendre.
(06/03/2002)
La route Rimbaud-Verlaine des Ardennes
existe : elle passe par les lieux fréquentés des deux compères. En été,
c’est un projet de week-end touristique agréable. Personnellement, je l’ai
toujours parcourue par bribes et lors d’obligations professionnelles. Charleville
bien sûr, la place Ducale (attention aux hôtels à proximité, le carillon sonne toute
la nuit), l’incontournable et touchant musée (ah ! la malle de Rimbaud), la
maison natale, la statue offerte par la municipalité et qui glorifie l’explorateur
et non le poète, la bourgeoisie locale ayant gardé ombrage d’écrits pas très
tendre à son égard. Mais l’endroit que je préfère est la tombe de Rimbaud.
Certainement parce qu’il n’y a rien à voir, que généralement, je la découvre
en repartant tôt le matin. L’endroit est toujours désert, les gardiens vous
regardent passer. On se tient debout devant la pierre blanche (j’ai le souvenir
d’arbustes d’ornement devenus envahissant) on regarde les noms, Arthur,
Vitalie… Derrière, un immeuble carré expose ses balcons et ses paraboles
télévisuelles. C’est le silence toujours.
Sorti de Charleville, je me suis souvent retrouvé au hasard devant des lieux perdus,
isolés, villages issus des champs ou des vergers, des pays ou l’on arrive jamais
comme Attigny, patrie d’André Dhôtel, et l’étonnant Roche, la ferme aussi où
fut écrite Une saison en enfer.
Oui, il faut parcourir cette campagne en été bien sûr, mais y revenir souvent en toute
saison, quand il pleut, quand la terre grasse des betteraves coule sur la route, quand les
maïs sont noirs, quand le ciel racle les pommiers alourdis, et discuter aussi, écouter
ses habitants, la rudesse et la franchise des " sangliers ", on
comprend alors mieux Rimbaud.
(27/02/2002)
J’ai fait plusieurs voyages aux
Antilles à la faveur d’un beau-frère installé en Guadeloupe depuis 10 ans et qui a
épousé une " payse " (comme on dirait cheû nous…). J’ai
même un moment pensé acquérir une petite case et un lopin de terre en haut d’un
morne des grands fonds et rêvé partager mon temps entre Karukéra et métropole. Et puis
j’ai suspendu mon rêve.
Car la vie là-bas n’est pas que cocotiers et plage, elle est dure et râpeuse,
tannée au soleil de bien des pauvretés : surpopulation, embouteillages,
travail insuffisant, dépendance permanente de la métropole (et de son incompréhension
bureaucratique), tout cela fait que la moindre action est compliquée. Survient donc le
royaume de la débrouille et pour cela, le métro moyen n’est pas équipé
avec ces rigidités, en face d’une hospitalité créole mais qui s’arrête (et
c’est bien normal) à ceux qui ont de vraies attaches là-bas. Car dans
n’importe quelle île, rares sont les Gauguin ou Brel qui ont pris la vie locale à
bras le corps pour y apporter leur pierre. Combien sont partis et sont devenus blancs-gâchés,
tendant la main sur les trottoirs de Pointe-à-Pitre.
Partager sa vie entre Karukéra et métropole, c’était être de nulle part et je
sais bien la force de ce qui me lie à mon " paysage du vide " natal
et choisi, même au-delà du froid et de ses pluies incessantes.
Tant pis, pour l’instant, je resterai le vacancier éternel. Adieu foulards, adieu
madras, je ne sais pas si je reprendrai un jour mon rêve.
(20/02/2002)
Quechua, c’est le nom
d’une ligne de vêtements d’hiver de chez Décathlon, lui-même nom d’une
ligne de magasins de sport.
Donc, voici deux ans, j’ai acheté dans un de ces magasins (où était-ce, Reims,
Troyes ?) une combinaison de ski de cette marque (la précédente m’ayant
lâchement abandonnée dans un irréparable accident de fermeture éclair un jour de grand
froid et blizzard et à deux mille mètres d’altitude, me laissant frigorifié
jusqu’au slip toute la dernière journée du précédent séjour.).
La semaine dernière lors d’un nouveau séjour dans les Alpes, j’ai donc pu
étrenner ce nouvel habit chatoyant à la marque sympathique laissant un parfum de guano,
d’aventure andine et de lama, (" Quand lama fâché, lui toujours faire
ainsi " Tintin et le Temple du soleil).
Quelle ne fut pas ma surprise de constater l’abondance de cette marque sur les
pistes : blousons, bonnets, gants, sacs à dos, chaque skieur semblait doté
d’un élément de cette panoplie ! De quoi réjouir bien entendu le PDG de
Décathlon, le directeur du Marketing de cette chaîne également qui doit se frotter les
mains pour avoir choisi un nom si " porteur " (pour ne pas dire
" sherpa " comme dans l’Himalaya...).
Mais de quoi aussi me sentir trompé quant à la marchandise : en effet, Quechua
que j’avais acheté, symbole de la liberté, des grands espaces solitaires seulement
survolés par de grands condors, m’avait transformé au pied des pistes en mouton
docile au milieu d’un troupeau de semblables (qu’on estime bien entendu plus
criards, plus grégaires, plus stupides que vous).
Je ne sais pas pourquoi je vous raconte cela : il est vrai que j’ai une dent
contre Décathlon depuis le jour où cette marque s’est réappropriée l’année
dernière le bâtiment d’un ancien Leclerc qui ne valait guère mieux mais qui avait
la chance d’être abandonné aux herbes folles depuis de nombreuses années.
C’est sur le parking désaffecté que mon fils a appris à faire du vélo (et pendant
longtemps pour faire durer notre plaisir à tous les deux). De grands condors nous
frôlaient de leurs ailes, nous contournions les lamas broutant les herbes rachitiques,
c’était le temps béni d’un après-marketing où les grandes surfaces
deviennent parfois comme par miracle de grands plateaux andins.
(13/02/2002)
Une nièce a fêté ses dix-huit ans : fête sympathique un samedi soir dans une
salle de village. Placé forcement du côté des parents, tontons et pépères, je
regardais machinalement le groupe joyeux et mouvant qui s’était constitué à
côté. Je devais avoir le regard rêveur : on m’a interpellé : - alors,
tu regrette tes dix-huit ans ? Non, comme Piaf, je ne regrette rien, mais du coup, je
me suis demandé comment on pouvait écrire la jeunesse (voir en Notes d’écriture)
et par quelle magie les enfants que l’on côtoie chaque jour vous retournent comme un
gant une vie toute neuve et déjà solide, une sorte de monde parallèle qu’on
n’avait pas soupçonné jusqu’alors.
Et bien sûr, quelle alchimie fait qu’on soit irrémédiablement passé dans le camp
des adultes ? Comment mesure-t-on les années ? Quel est le poids du temps
passé entre vos dix-huit ans et votre âge ? Comment le voit-on ? Par quels
signes ? Les réponses paraissent trop évidentes, la descendance qui vous suit,
l’aspect physique moins fringant. Mais pourquoi la tête ne vieillit-elle pas ?
Pourquoi ressort-on intactes des idées vieilles de dix, quinze, vingt ans ? Et cette
attirance pour les confronter à d’autres idées plus neuves et le refus qu’on
vous oppose parce que, eh bien oui, vous avez glissé dans un autre monde clos,
hermétique, un espace qu’on appelle une génération de plus. Ce n’est pas
très agréable, le temps qui a passé à votre insu...
Mais soudain, cette génération de moins s’empare d’un accordéon, vous joue
une valse qui, elle non plus n’est pas de votre temps. Qu’importe, vous sautez
par-dessus vos dix-huit ans, Rolling Stones et Deep Purple, vous rejoignez la jeunesse de
vos parents et vous tournez, tournez dans un espace et un temps qui se mordent la queue.
(30/01/2002)
La semaine dernière La Traction 15 de Pierre Bergounioux m’évoquait un souvenir de
vitesse, jeunesse et folie automobile. Le mauvais sort a voulu qu’un accident
terrible se produise dans ma ville : voiture pulvérisée, deux morts, trois
blessés, tous âgés de vingt ans, selon un triste scénario de sortie de boîte de nuit,
à 5h du matin.
L’un d’eux était agent de sécurité à l’Hôtel de Police de ma ville.
Quelqu’un de bien : un médiateur, un exemple pour les jeunes de quartiers
difficiles comme on dit. On a organisé pour leur mémoire une marche silencieuse, une
veillée chez les policiers. On s’est fait l’écho de cette fatalité : il
y avait du verglas dans cette nuit du samedi au dimanche.
Vies fauchées, tristesses…
Il me semble que je connaissais la voiture, un cabriolet mauve, était-ce la même que
j’avais vu remonter un soir une rue en sens interdit et prendre le rond point à
contre sens ? Celle rencontrée quelques heures avant le drame (garée au
milieu d’un carrefour, son conducteur discutait avec l’occupant d’un autre
véhicule) ?
On sait que la voiture roulait très vite en agglomération au moment de l’accident.
Vitesse, vitesse… J’ai possédé il y a quelques années un véhicule capable de
vitesses inavouables. J’en garde des souvenirs de puissance : accélérations,
paysages tranchés au couteau, une moyenne de 200 sur l’autoroute de Barcelone, un
jour d’été, avec cinq personnes à bord, et, un soir, en revenant tout seul
d’Avignon, la frustration de n’avoir pas pu pousser à fond la mécanique faute
d’espace (à plus de 230, il y a toujours une voiture devant vous qui vous oblige à
ralentir).
Comme tant d’autres, je n’ai pas compté les dangers, ni pour moi ni pour les
autres, je me suis laissé prendre par cette illusion du temps raccourci, vouloir
accélérer sa vie en quelque sorte, ce leurre qui a séduit beaucoup
d’écrivains : Roger Nimier, Françoise Sagan, jusqu’à Blaise Cendrars qui
pilotait dans les années trente une extravagante Alfa Roméo avec son unique main.
Et puis j’ai changé, du moins je pense : j’ai une voiture moins rapide, je
ne guette même plus la maréchaussée sur les bas côtés, j’essaie de garder de
bonnes distances, de bien mettre mon clignotant…etc. Je conduis à la pépère comme
on dit et c’est avec ce même état d’esprit que je pense à ce drame.
Quelle image de héros et de jeunesse veut-on donner à travers cette marche à leur
mémoire ?
Pourquoi faire semblant d’ignorer cette vitesse, accuser avec hypocrisie le verglas
que l’on sait permanent depuis un mois et qui n’est pas la cause de la gravité
de cet accident ?
J’ai l’impression de vieillir, de devenir un vieux con, mais bon :
j’aurais voulu qu’eux aussi comprennent à temps cette chimère inutile
qu’est la vitesse.
(23/01/2002)
Ma fille a inventé un jeu : elle prononce un mot au hasard, n’importe lequel
pourvu qu’il soit incongru à la situation. La situation ? Ce peut être
n’importe quand : en voiture, quand je l’emmène à son cours de solfège,
dans la cuisine quand j’épluche des légumes pour la soupe. Elle surgit, prononce un
seul mot, " chacal " par exemple, et je dois puiser à
l’intérieur de mon crâne pour rétorquer par un autre mot tout aussi isolé et
incongru.
C’est un peu bête non ? Pas si sûr…
Ce jeu, qui n’est pas sans rappeler les cadavres exquis des surréalistes, est
cependant extremement ardu malgré sa simplicité. Autant les disciples d’André
Breton étaient " en condition ", c’est à dire réunis dans un
lieu pour un tel exercice de créativité, autant le jeu de ma fille peut survenir
n’importe où et n’importe quand et, dans l’immédiat instant où je
comprend le démarrage du jeu (je suis le seul joueur), je sais que je dois quasiment
avoir répondu.
En effet, au bout de quelques jeux, on réalise que plus le temps passe entre le premier
mot et sa réplique attendue, plus le cerveau s’est mis en marche, à analysé le
sens du mot, ou la situation, ou le lieu, ou l’action qu’on est en train de
faire et plus la réponse sera convenue, avec des analogies. Par exemple, si ma fille
prononce " chacal " alors que j’épluche des légumes, pas
question de répondre " soupe " ou " plat à
gratin ", trop évidents avec la cuisine que je suis en train de faire, pas
question non plus de prononcer " lion " ou
" tigre " qui complèteront " chacal ". Nous
jugeons notre réussite par la rapidité de réponse et l’absence de lien avec le mot
précédent, la situation du quotidien, etc… Par exemple
" mappemonde " ou " tiroir-caisse " immédiatement
répondu à " chacal " pourront être considérés comme de bons
exploits ! Au bout du compte, l’impression qui demeure devant un de ces
exercices réussis, c’est un peu comme avoir ponctionné au fond du cerveau dans une
partie inconsciente un élément disjoint du langage que nous possèdons et qui est
forcement comparatif, visuel, auditif, chargé de sens. Les mots les plus rapides qui me
viennent à l’esprit sont souvent des phonèmes, des syllabes détachées de toute
langues, des onomatopées. Avoir envie de rétorquer à " chacal ",
" Pfuit " ou " tagada ", pouvons nous considérer
cela comme une réussite à notre jeu ? Il faudra que je soumette cette question à
ma fille…
(16/01/2002)
Qu’y a-t-il comme différence entre
John Lennon et Arthur Rimbaud ?
Aucune : " des peaux rouges criards les avaient pris pour
cibles " pour citer Bateau Ivre (voir en Notes de Lecture) et pour se
remémorer qu’Imagine a été interdit sur les radios américaines pour cause
de subversion pacifique après les attentats du 11 septembre (voir Etonnement du
26/09/2001)…
On revient à lui cette semaine car ma sœur a eu la bonne idée de m’offrir un
CD de John Lennon pour Noël avec la non moins subversive chanson de circonstance Happy
Xmas (et son sous titre War is over). Ecrite en 1971, trente ans déjà, et
c’est comme un éternel recommencement sauf que là, on laisse les Américains
conduire leur croisade " juste " (sic !) contre la barbarie et
pour leurs intérêts dans l’indifférence générale. Serions-nous devenus plus
cyniques qu’il y a trente ans ?
On pourra lire aussi sur le même sujet l’édito de Patrick Cahuzac dans
Inventaire-Invention.
(09/01/2002)
" Bonne année, bonne santé et le
paradis à la fin de vos jours ! ". On a tous dans nos souvenirs des phrases comme
celles-çi chantonnées lors des visites traditionnelles du premier janvier dans nos
familles.
Chez mon grand-père, il fallait viser le bon créneau horaire : pas trop tôt car il
regardait le concert du premier janvier à la télé et pas trop tard parce qu’après
l’heure c’est plus l’heure… Il feignait l’étonnement de nous
voir arriver. On disait la phrase, on les embrassait. (En réponse," Tu frises,
poulet " ou " Turlututu chapeau pointu " avec les cheveux ébouriffés). La
cuisine sentait la soupe, il y avait un poste de TSF religieusement posé sur un napperon.
Ma grand mère sortait des cacahuettes rances et des verres couleur lie de vin. Dehors,
c’était parfois tout blanc. Je regardais les traces rondes des pots de cactus du
jardin exotique remballé pour l’hiver. Ma sœur mangeait le crépi des murs par
défi. Quand nous avions froid, nous rentrions sous l’escalier pour lire toujours le
même livre de contes (Ah ! l’image de la princesse perdue dans la forêt et
attaquée par les loups, le sang dans la neige…). Dans la pièce à côté, les
paroles des adultes étaient rares et pesées, on s’échangeait des nouvelles
("J’ai vu monsieur… monsieur… Tu vois bien, celui qui habitais à
côté de la tante machin… Si… Tu sais, celle qui avait perdu son mari à la
guerre… Tu ne connais qu’elle"…etc). Les heures étaient lentes, il y
avait un carillon avec un balancier aux reflets d’argent derrière la glace
biseautée.
(01/01/2002)